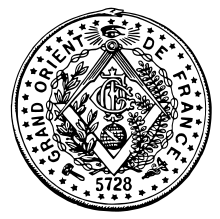C’est une question que les médecins se posent à longueur de journée ! Mais c’est aussi une question qui préoccupe tout un chacun que ce soit dans la sphère privée « M’aimes-tu encore ? « , dans les activités professionnelles et aussi dans l’activité publique ! Même les enfants « Papa, pourquoi préfères-tu mon petit frère ? » ! Question transversale qui existe aussi en loge « J’ai été bon ce soir ? » ! Que répondre ?
On ne rentrera pas dans le débat » philosophique » qui comme tous les débats de ce genre « botte en touche » avec des « peut-être », « pas totalement », « avec tact et mesure », etc.
En ce qui concerne la démarche maçonnique, nous devons très prudents dans la mesure où notre préoccupation affichée c’est « la recherche de la vérité » ! Cette « galanterie » du langage autorise tous les « exercices » de la pensée ! Chacun sait qu’on est globalement pas très bons mais faut-il le crier sur les toits ? Faut quand même pas être maso !
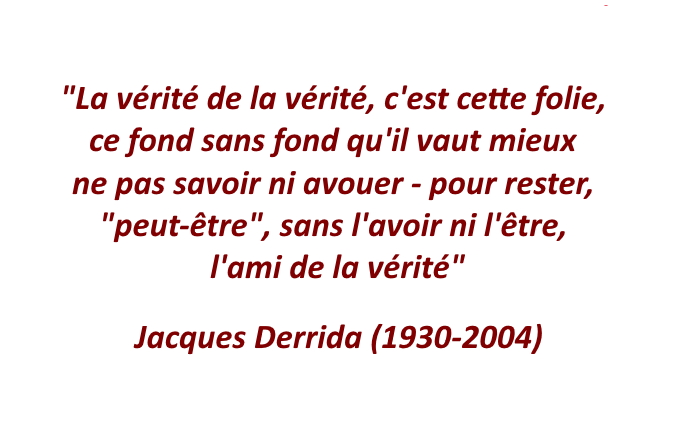
Etre « à la recherche de… » nous laisse libres d’énoncer des contre-vérités, voire de fabuler ou d’avancer des hypothèses plus ou moins farfelues !
Cette formulation qui d’une certaine manière figure dans notre ADN collectif a mis sur la Franc-Maçonnerie le sceau du « Pas Sérieux » qui nous colle à la peau et explique toutes les difficultés que nous avons à être crédible !
Comment affirmer être sérieux quand on prétend ne pas connaître la Vérité ?
Personne ne peut vous croire puisqu’on avoue ne pas savoir ! Je ne sais pas qui est l’auteur de cette formule la plus creuse qui puisse exister mais elle vaut son pesant d’or et de cacahuètes ; celles et ceux qui la répètent comme « Parole d’Evangile » ont compris combien elle était riche de sens !
Mais ce « Pas Sérieux » nous permet aussi d’exister, de recruter et de rêver, car les « Pas sérieux ! » ne sont-ils pas plus bons vivants que les « Sérieux » qui sont tristes à mourir ?
Mais tout se complique lorsque le rituel nous incite à «répandre les vérités acquises». On comprend bien que dans l’Europe du XVIIIème siècle l’inspiration des rituels maçonniques était d’ordre biblique et ces fameuses « vérités acquises » concernaient la foi dans le Grand Architecte de l’Univers autrement dit Dieu ! Mais dire que les rituels c’est du tout et du n’importe quoi, c’est bientôt trop sérieux pour être affirmé !

Au XVIIIème siècle, nous sommes sur ce sujet de la Vérité comme une médaille avec ses deux faces : « Pas Sérieux » d’un côté car sans vérité et débordant de vérités de l’autre soi-disant acquises par la pratique maçonnique : occultisme, astrologie, kabbale et autres « grandes vérités sur les mystères » !!
Dans un numéro d’ Humanisme , la revue du GODF, Youri Chelkovski signe un aricle initulé « Le bêtisier du franc-maçon » dans lequel il aborde cette question de la confusion entre vérités et recherche de la vérité.
Ne pas dire la Vérité, c’est de facto mentir mais cela fait toujours du bien surtout lorsqu’on vous annonce que vous allez bientôt guérir alors que vous êtes dans le service des soins palliatifs ! Le mensonge n’est-il pas toujours paré des plus bienveillantes intentions ?
En tous les cas on pourrait le croire tellement le mensonge est devenu une institution langagière ! L’actualité récente, avec le défoulement provoqué par l’épidémie de la Covid-19, en a donné une excellente illustration ! Les fake-news font plus facilement le buzz que la parole sage et mesurée de celui qui sait qu’il ne sait pas !
Aujourd’hui, aucune information n’est devenue crédible d’emblée même celle qui concerne la recherche scientifique : une enquête s’impose pour en vérifier l’authenticité !
Alors imaginer tout ce qui s’écrit sur la franc-maçonnerie par des autodidactes qui donnent leurs sensations et qui ont parfois tendance à se prendre au sérieux !
Mentir est une pratique naturelle et spontanée ! Nous mentons tous allègrement avec le sourire et la conviction d’être bienveillant ! Car Mentir c’est éviter les conflits, trouver une porte de sortie élégante, faire de l’humour et finalement rendre l’autre heureux ! A 450.fm on est bien placé pour savoir mentir ! Faut dire qu’avec notre grand chef de la publication, on est à bonne école !
J’imagine les tourments de notre rédaction quand nous autres, modestes contributeurs sans expérience, nous leur envoyons le fruit de nos cogitations :
« Faut-il leur dire que leurs articles ne valent pas un clou ? »
« Le silence règne sur l’une et l’autre colonne, VF Rédacteur en chef ! ».
Doit-on dire en loge qu’une planche est exécrable et ennuyeuse ? Jamais de la vie ! Ce sera « Mon TCF, j’ai beaucoup apprécié ton travail , mais …. » ; ou « Ma TCS, ta planche est remarquable et j’ai beaucoup appris mais ne penses-tu pas que … » !
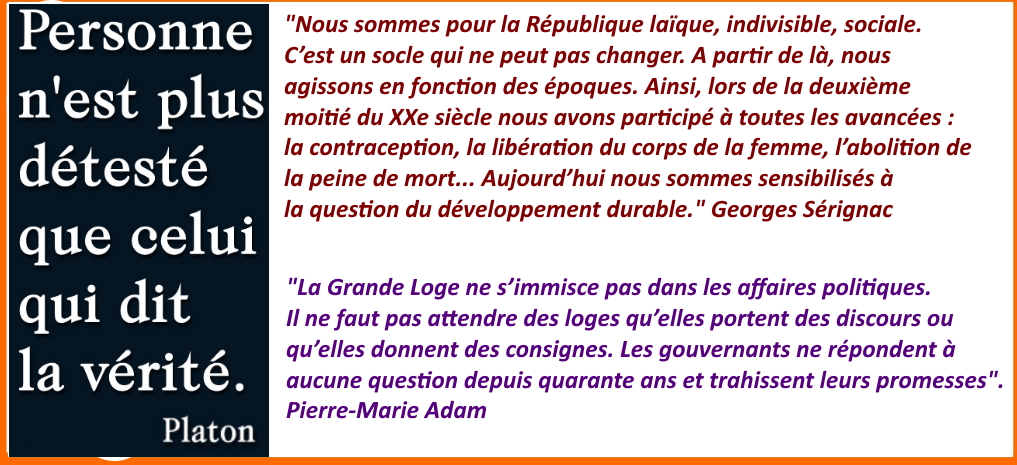
En vérité, je vous le dis, la Vérité est un secret qu’il ne faut surtout pas divulguer ! Chacun sait que la plupart des prises de parole n’ont pas pour but de dire la vérité mais de faire croire qu’elle nous préoccupe !
Si vous l’annoncez « Urbi et Orbi », elle ne sera pas reconnue comme telle et perdra sa crédibilité !
Dans ce monde de folie qui nous mène à la perte, dire la Vérité n’a plus de sens, gardez la pour vous, n’en parlez jamais et vous la préserverez !
Il n’y a qu’une seule exception à cette règle ; on ressent parfois la nécessité de transmettre la Vérité ; (Faut bien reconnaître que généralement la mort n’est pas loin); c’est un besoin intime à l’intention d’une personne particulière pour laquelle un mélange d’affection et de respect vous lie. C’est exceptionnel mais lorsque cela arrive, il faut mieux le faire ! Cela fait du bien !




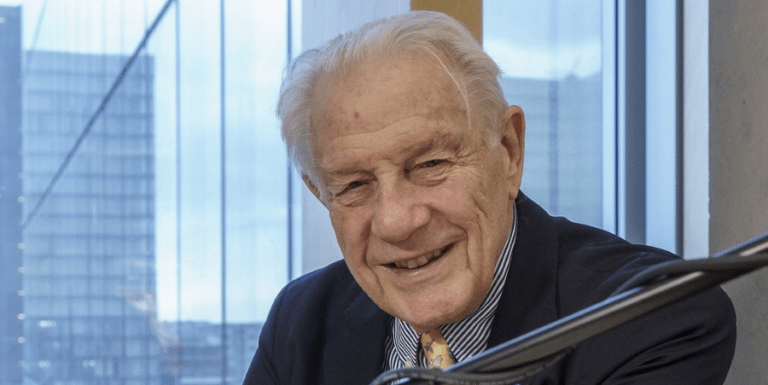
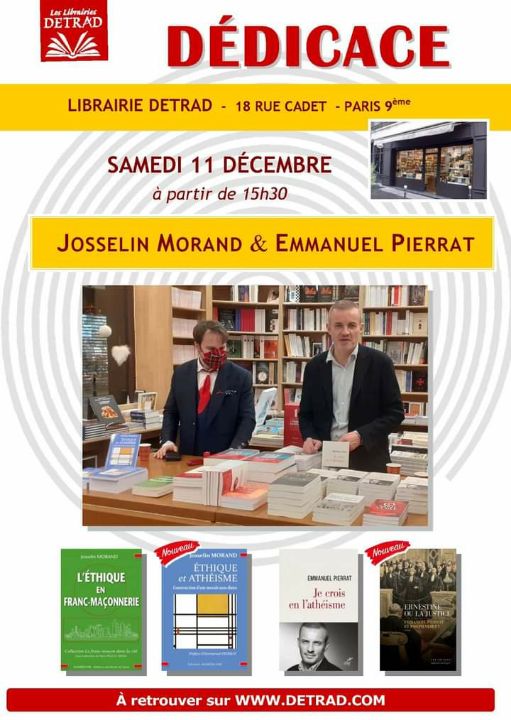



 la Constitution. Washington confie à Pierre-Charles L’Enfant la mission de concevoir et d’aménager la nouvelle capitale sur un terrain vierge en forme de diamant.
la Constitution. Washington confie à Pierre-Charles L’Enfant la mission de concevoir et d’aménager la nouvelle capitale sur un terrain vierge en forme de diamant.