« Le mythe a été sauvÉ de l’oubli et ne s’est point perdu. Il peut, si nous y ajoutons foi, nous sauver nous-même »
Platon (La République, Livre X)
Dans son livre : « Œil ouvert et cœur battant » François Cheng conduit son lecteur à la notion de résonance. Il écrit (1) : « Les touches de Fra Angelico, de Botticelli, de Rembrant, de Vermeer, de Poussin, de Watteau, c’est l’âme qui résonne ». Cela veut dire qu’il ne convient pas de plier sous le prestige de quelques grands noms, mais d’utiliser, dans la profondeur de leur sublimation nécessaire, un lieu de construction de soi et de liberté.
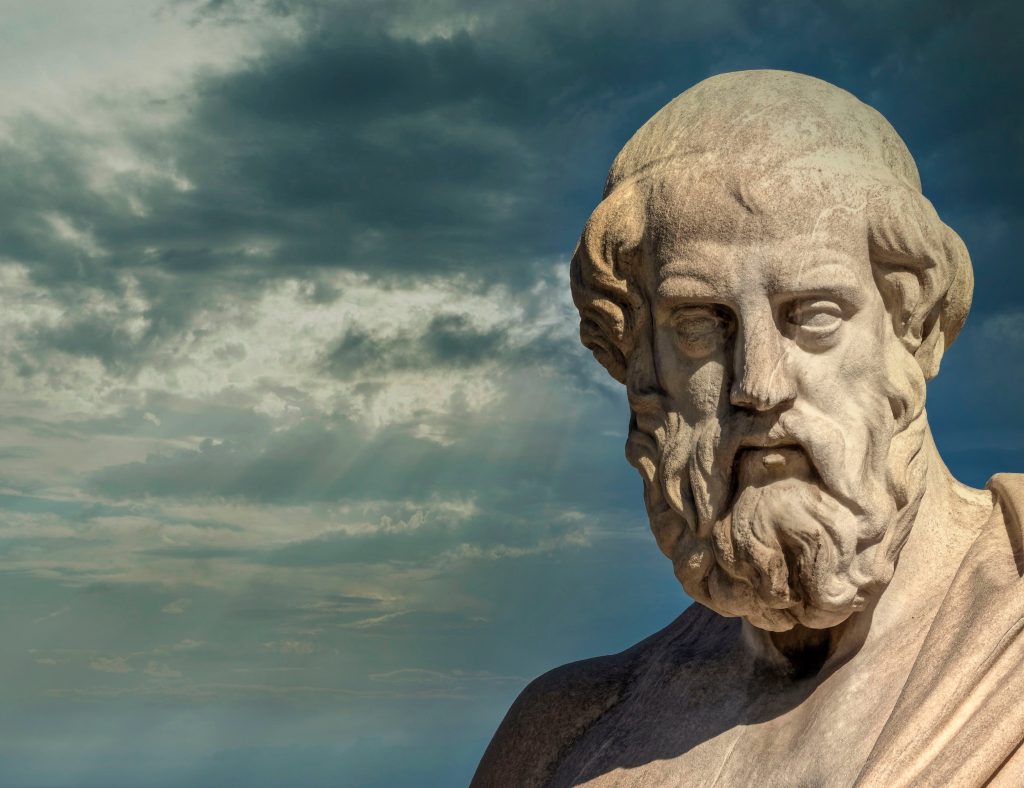
S’ils deviennent incontournables c’est qu’ils sont devenus un catéchisme qui est récitation et fin de l’innovation. Nous pourrions dire que l’allégorie de la caverne de Platon relève de cette dérive, en particulier en Franc-Maçonnerie où elle est devenue presque un élément du rituel et où il serait indécent de n’en pas faire référence. Mauvaise note si la caverne est oubliée !
Mais, l’allégorie est-elle une référence à la pensée maçonnique ? Platon dans « La République » prend il l’exemple de la caverne et de l’ascension vers la lumière et la spiritualité comme un « remake » terriblement employé dans l’Antiquité et par la suite dans le christianisme (Et la Franc-Maçonnerie !), ou se sert-il d’une allégorie classique pour nous parler science-politique et création d’une élite qui serait les philosophes (Ou les despotes « éclairés »). C’est un texte où la contrainte sans visage existe, presque un impératif kantien à aller vers la lumière, en tout cas une tension dictée de l’extérieur : on veut que je grimpe alors que je peux me sentir bien dans ma médiocrité et les faux-semblants ! Le Maçon a le choix de son ascension, pas le captif de la caverne qui échappe à lui-même. Le philosophe Claude Romano écrit (2) : « On ne commence à être soi-même que lorsque l’on ne se préoccupe plus du tout de l’être ». Aborder une comparaison de l’allégorie de la caverne et de l’idéal maçonnique oblige à plusieurs cheminements : la différence entre mythe et verbe, évoquer la similitude entre le « Banquet » et l’allégorie de la caverne et, enfin, aborder la différence entre mythe (terme souvent employé) et allégorie pour la caverne platonicienne.
I – Mythos ou Logos ?

Evoquer le mythe, c’est prendre conscience du divorce qui va s’effectuer, peu à peu, dans la Grèce classique entre la naissance d’un rationalisme scientifique et philosophique et le récit mythique. Entre « Logos » et « Mythos », le fossé va se creuser : la philosophie cherche les fondements de ce qui exclut la fiction et donc elle condamne le mythe, qui lui de son côté pense que la vérité ne se laisse pas enfermer dans le seul langage de la rationalité conceptuelle. Platon est lui-même prit dans cette ambiguïté : il veut donner à la recherche de la vérité une rigueur de démonstration et de langage et ne cesse, par exemple, de manifester une grande défiance vis-à-vis des poètes ; pourtant son œuvre est nourrie de récits mystiques qu’il prend à la tradition et qu’il remanie au gré de sa fantaisie ou des besoins de sa démonstration. Il en invente même de toutes pièces ! Il crée un genre nouveau : à l’intérieur du « mythos » antique, même s’il s’en inspire souvent, il ne se confond ni avec les récits de la mythologie grecque, ni avec les histoires légendaires telles qu’elles nous furent relatées par Homère, Hésiode, les tragiques ou les poètes orphiques. Platon lui-même a esquissé une critique des mythes dans « La République », tout en se servant de ce patrimoine au service de ses idées philosophiques. Nous pouvons dire qu’il fait coïncider mythologie et philosophie de façon naturelle et complémentaire à son service. Dès lors, nous pouvons définir le « mythe platonicien » de la manière suivante :
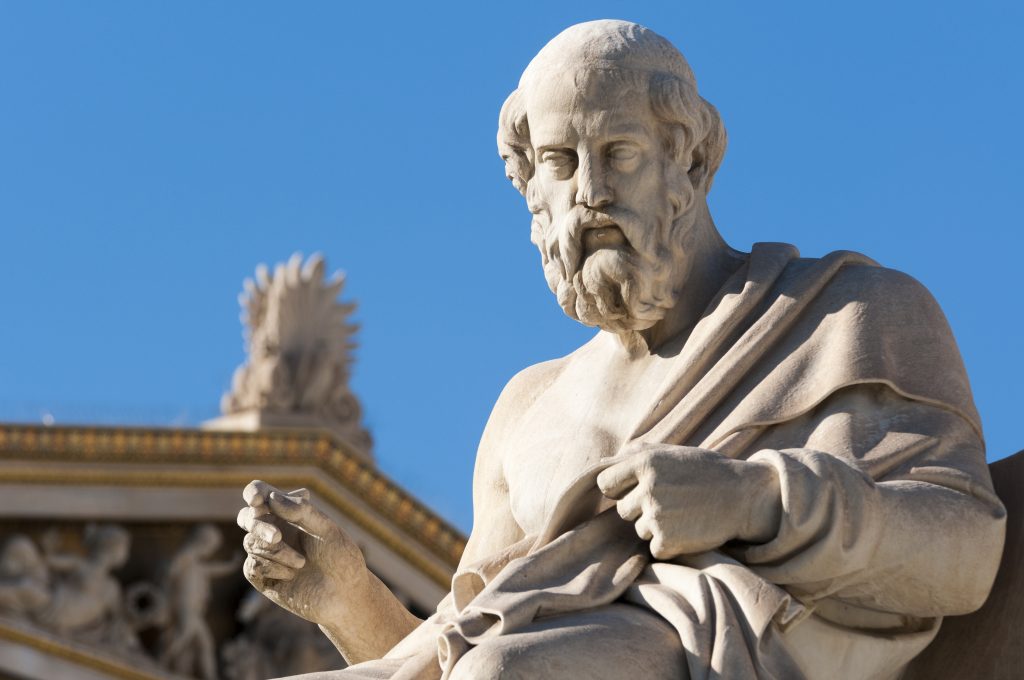
– Le mythe se présente à la manière d’un récit fictif. Sa forme narrative le rapproche de la fable, de l’allégorie, mais le distingue de la simple image, de la métaphore ou de l’analogie dont l’œuvre de Platon est remplie par ailleurs.
– Le mythe rompt avec la démonstration dialectique : il fait appel à l’imagination plutôt qu’au raisonnement, faisant appel à la sensibilité esthétique ou au sentiment religieux.
– Le mythe n’est pas en tant que tel une méthode pour chercher le vrai, mais un moyen de dire le vraisemblable. Il intervient là où la dialectique est inopérante et ne peut donc prétendre au vrai.
– En revanche, le mythe a la prétention du sens. Il n’a pas à être lu et écouté pour lui-même, mais être saisi dans son sens caché. Il est porteur de message et demande donc à être dépassé, traduit, interprété, déchiffré, si l’auteur nous donne les clés d’un décryptage possible, ce qui le cas de l’allégorie dont le sens est explicité image par image.
– Le mythe contient une double intention pédagogique : éclairer l’interlocuteur en difficulté et délasser son esprit fatigué, ou soutenir une discussion qui s’enlise ou piétine. Le mythe se veut donc un stimulant moral et parfois spirituel.
Léon Brunschvicg (3) voit dans l’utilisation du mythe « le retour offensif d’une pensée prélogique ». Nous pourrions y voir plutôt un « Deuteros plous », un changement de cap, auquel Platon nous invite dans le « Phédon » : là où la dialectique se bute au mystère impénétrable, le philosophe préfère à la négation ou au scepticisme l’option hardie pour une croyance, indémontrable certes, mais justifiée néanmoins par son efficacité morale et sa fécondité pragmatique. Treize mythes sont représentatifs dans l’œuvre de Platon, auxquels s’ajoutent trois petits mythes annexes. Une classification peut s’opérer de différentes manières :
– Par la forme et la fonction : on peut distinguer les mythes allégoriques ( Prométhée, Theuth), génétiques (naissance d’Eros, Atlantide) et parascientifiques (la genèse du monde, le séjour de l’âme après la mort). Mais nous pouvons adopter aussi une distinction triple : mythes allégoriques, mythes-conjonctures, mythes-expression d’une conviction.
– Par leur contenu à partir de grands axes thématiques : la condition humaine, la libération spirituelle, la destinée des âmes et le devenir du cosmos.
Le mythe est un éclairage incontestable de l’œuvre de Platon. Entre mythos et Logos, il ne choisira jamais, car il sent leur nécessaire complémentarité dans les grandes interrogations qui sont les siennes et celle de la « Philosophia perennis ». Le mysticisme philosophique paraît comme la continuation du mysticisme religieux où l’homme, dans l’un comme dans l’autre, se laisse absorber par son moi intime. La seule différence qui sépare le mystique philosophique du mystique religieux consiste en ce que le Dieu que celui-là recherche dans les profondeurs de son propre être s’appelle connaissance… Mais le but est le même dans les deux cas : l’ « Unio mystica », la fusion intime avec le Tout. Connaissance et amour sont liés : il ne faut pas oublier qu’en hébreu connaître signifie coïter ! Il nous apparaît donc utile qu’avant d’aborder l’allégorie de la caverne qui est par excellence celle de la connaissance que nous puissions mettre la deuxième démarche vers la fusion mystique du Banquet en parallèle, Platon nous laissant le choix du cheminement vers la vérité du sujet. L’œuvre de Platon s’harmonise autour de deux textes qui conduisent précisément à le vérité du sujet qui est d’atteindre le domaine des Idées en ayant abandonné l’objet qui servait de relais à ce cheminement et qui débouche sur la fusion. Les autres textes nous y préparent ou ne sont que des annexes de ces deux œuvres. Le Banquet et La République illustrent l’essentiel de cette démarche mystique et philosophique. Evoquer l’un suppose que nous devions parler de l’autre, car pour Platon, atteindre le domaine des Idées passent par le choix de l’amour ou de la connaissance.
II – Le Banquet comme similitude a l’allégorie de la caverne (Le Banquet 209e-209 b).

Le récit présente trois caractères qui peuvent le rattacher d’u style d’une narration mythique :
– Il est continu : Socrate y joue le rôle d’un néophyte initié qui se laisse emporter par les déclarations.
– Il est inspiré : une prêtresse, Mantinée, y intervient. On peut y voir sans doute un personnage fictif qui serait un moyen à Socrate et à son Démiurge de donner leur avis. En tout cas le vocabulaire utilisé ressemble à celui dont parle le Phèdre et qui est le vocabulaire des mystères d’Eleusis.
– Il est suggestif et évocateur : il évoque une compréhension supérieure et fait appel à une herméneutique. Le discours de Diotime se meut dans le champ du mythe platonicien, meilleur moyen d’unir, dans la forme comme dans le fond, l’inspiration à la philosophie. Il est d’ailleurs difficile de séparer les deux grands textes platoniciens sur la dialectique ascendante de l’âme, celui de La République (allégorie de la caverne) et celui du Banquet (révélation de Diotime). Il y a chez Platon deux formes d’ascension spirituelle, l’une vers la vérité, l’autre vers la beauté, et deux voies médiatrices : la connaissance et l’amour. Pour avoir parlé de l’une, il nous faut parler de l’autre.
Le Banquet repose sur le mythe d’Aristophane qui est celui de l’androgyne et qui met l’accent sur notre incomplétude fondamentale : sur l’ordre de Zeus, nous avons été coupés en deux, ce qui amène pour l’homme les conséquences suivantes :
– Nous vivons sur le monde de la mutilation et de la séparation. Il est d’ailleurs amusant de relever, dans le langage populaire, que l’on parle du conjoint comme de « ma moitié » !
-Eros n’est que la nostalgie de notre unité perdue. Eros lui-même d’ailleurs a pour mère Carence et Pénurie et tout son être n’est que manque. Heureusement, par son père, il sait trouver les moyens de ses fins (« Poros »), et il est inventif, créatif plutôt que créateur. L’aspect positif d’Eros est qu’il incite le sujet à sortir de lui-même, à se dépasser. Au mieux, nous pouvons retrouver l’unité dans une fusion en vase clos, totalement fermée sur elle-même et qui se transforme de nouveau en une incomplétude angoissante dès que cette fusion artificielle est terminée.
Le discours initiatique, cependant, fait progresser la connaissance : l’objet de l’amour, selon Diotime, est un « enfantement dans la beauté, soit selon le corps soit selon l’âme ». A la tension vers ce que l’on n’a pas et qui est le moteur du désir, s’ajoute le désir de fécondité. L’amour est fécond dans sa banalité de procréation et dans celle de création intellectuelle, spirituelle ou artistique. Mais après l’initiation (téléa, époptika) vient la révélation : nous devons alors nous élever des beautés sensibles à la Beauté absolue, en gravissant un à un les degrés de l’échelle. L’amour est un moteur de transcendance qui se sert de la matérialité changeante de l’objet de l’amour, afin d’atteindre l’éternité de l’idée. Pascal Quignard fait largement allusion à la force de la sexualité qui utilise les objets pour une autre destination que celle du pur plaisir. Il écrit (4) : « La sexualité comme polymorphe, aberrante, errante. La sexualité humaine désynchronisée, sans objet, désinstinctualisée, ne se réalise jamais. Elle aberre dans le monde. C’est un ça qui a faim, qui a soif, qui a sommeil, qui désire, qui rêve. Qui bout comme la terre qui explose et laisse fuser sa lave. Désir sexuel qui se pose çà et là et qui différencie tout pour tuer et pour mourir, pour rénover tout par la mort ». L’ascension vers la réalité suprême, à-travers le beau, se fait par étapes, « gradatim » dirait Descartes, sous la conduite d’un guide reconnu qui serait le maître-maïeute de la réminiscence, l’accoucheur des esprits, ou le guide mystérieux (le « ON ») de l’allégorie de la caverne. Cette dernière s’inscrira dans une réflexion globale sur l’éducation du philosophe, futur gouvernant de la cité, et ne sera essentiellement qu’intellectuel : décrire le mouvement ascendant de l’intelligence, de l’illusion de savoir au savoir véritable, la rectification des faux savoirs et l’acquisition des vrais savoirs. Dans le Banquet, l’essentiel serait le même : le Vrai, le Bien, le Beau, ne sont que des manifestations de la même et unique Réalité Suprême. L’amour est « Metaxu », intermédiaire entre moi et l’autre, intermédiaire entre des contraires, mais surtout intermédiaire entre le sensible et l’intelligible, entre l’humain et le divin. C’est de cela dont on parle quand on évoque l’ « amour platonicien » qui n’est que l’utilisation de l’autre pour parvenir à une transcendance, « s’envoyer en l’air » ! Si le sujet met espoir dans l ‘amour relationnel, il ne va qu’à la déception car la visée est plus métaphysique que charnel Ce que disait Jacques Lacan à travers sa célèbre définition de l’amour : « C’est vouloir donner ce que l’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas » ! Lui-même animera un séminaire (1960-1961) sur le thème du Banquet, intitulé : « Le Transfert ». Le Banquet nous amène à la question de l’amour comme nécessité ou comme passage. Platon, d’une certaine façon, nous dit que nous aimons l’autre parce qu’il nous sert à parvenir, à-travers le plaisir, à une dimension spirituelle qui serait de loin la plus importante et si le partenaire ne répond plus à cela, il y aurait recherche, transfert sur un autre. Vision pessimiste que nous allons retrouver dans l’allégorie de la caverne.
III – La caverne : mythe ou allégorie ? (La République vii, 514 a- 519 d)

Il est important de comprendre que La République et les Lois sont, avant-tout, des écrits politiques et que les mythes ou allégories utilisées sont là pour présenter ce qu’il en serait d’une cité idéale dirigée par une élite, alors qu’au départ c’était la figure du tyran qui devait occuper la place de dirigeant unique, en prenant l’avis de philosophes éclairés. Place que revendiquait Platon auprès du tyran Denys Ier à Syracuse en Sicile à la suite de son invitation, aux environs de 388, alors qu’il a une quarantaine d’années. Denys Ier est le maître absolu depuis 17 ans et règne presque sur toute la Sicile. Il est capital de faire mention qu’il enferme ses ennemis dans une grotte dénommée « l’oreille de Denys » (l’histoire nous disant que le tyran venait écouter ses victimes car la sonorité lui permettait d’entendre leurs discours et leurs plaintes et où il les laissait mourir de faim). Cette grotte se visite encore aujourd’hui dans les environs de Syracuse et est à la base du texte platonicien. Platon, désireux de convertir Denys Ier en tyran éclairé va se servir de cette sordide réalité pour la transformer en allégorie, où il veut présenter le pouvoir d’état aux mains d’un philosophe qui permettrait à quelques-uns de sortir de l’ombre pour partager le pouvoir avec lui. Ces « happy few » venant des classes moyennes et aspirant à rejoindre l’aristocratie. Ce qui vaudra à Platon l’étiquette, par les marxistes, de « Philosophe de la petite-bourgeoisie » ! Bien entendu, pour Denys Ier, il n’est pas question de partage du pouvoir et, à terme, jugera comme inopportune la présence de Platon en Sicile. Ce dernier rentrera à Athènes en 387, guérit des tyrans ! Le choix du renvoi de Platon par Denys Ier avait été dicté par son hostilité à Athènes après la condamnation de Socrate à boire la cigüe. Platon, revenu à Athènes va se consacrer à la fondation de l’Académie qui est le rêve d’un centre d’éducation de la jeunesse pour la formation d’une élite dont le modèle reste le philosophe, et qui serait destinée à la conduite des affaires de l’État. Eux seuls redescendraient dans la caverne pour y diriger ceux qui veulent rester dans l’ombre. Naturellement, il va se servir de l’allégorie de la caverne pour un enseignement qui reste politique en priorité et dont l’idéal est la constitution d’une société de castes, à l’image de l’Inde : brahmanes, guerriers et producteurs. L’anthropologue Georges Dumézil (1898-1986) avait d’ailleurs souligné l’héritage philosophique indo-européen chez les philosophes Grecs et leur conception tripartie de la société. Mais, bien entendu, les interprétations de cette allégorie vont être multiples Examinons-en quelques-unes.
La caverne nous intéresse en général car elle a, inconsciemment, pour chaque sujet, des résonances intimes profondes qui se traduisent, soit par une sensation de plaisir, soit par une sensation d’angoisse, en faisant référence à la sexualité ou à la situation prénatale. La caverne est le lieu mythique où nous entrons et sortons, que nous recréons après notre naissance, comme le « lieu d’avant » (la maison, l’église, la voiture, le parti, la loge, etc.) La sexualité elle-même est une tentative de retrouver le lieu amniotique qui ressemblait à un paradis. Comme dans l’allégorie platonicienne, les hommes n’ont guère envie d’aller vers la lumière extérieure, où ils sentent qu’ils ne vont trouver que des paradis artificiels, jamais satisfaisants par rapport à celui qu’ils quittent à la minute de leur naissance, là où le cordon ombilical est coupé. Freud y verra l’ « instinct de Nirvana » comme aspiration à l’ « éternel retour ». Le psychanalyste Otto Rank (1884-1939), dans son célèbre « Le traumatisme de la naissance » (1924) fait référence à Platon et sa caverne (5) : « L’idéal platonicien qui se manifeste dans cette manière de voir, la rupture avec le monde sensible, qui était pour Platon la rançon de son orientation vers le monde intérieur, trouve une admirable expression, et qui projette une vive clarté sur ce qu’il y a de subjectif dans les idées de Platon, dans sa célèbre comparaison de l’existence humaine avec le séjour dans une caverne souterraine sur le mur de laquelle on ne voit que les ombres des choses et des événements réels. La comparaison avec la caverne n’est pas seulement, ainsi que l’avait soupçonné Winterstein, un « phantasme ayant pour objet la vie intra-utérine » : elle nous permet, en outre, de pénétrer profondément dans l’esprit du philosophe qui tout en conservant l’Eros, le grand stimulateur de toutes choses, comme le désir nostalgique du retour à l’état primitif, créa cette conception, dans la théorie des idées, ce qui peut être considéré comme l’expression de la plus haute sublimation philosophique »…
Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler ici ce qu’il en est de la différence entre le mythe et l’allégorie :
– Le mythe raconte une histoire et met des personnages individualisés, situés dans le temps et l’espace et a une signification implicite
– L’allégorie décrit un état, « comme un tableau immobile », nous dit le philosophe suisse Perceval Frutiger. Elle est de portée essentiellement générale et présente des types d’humanité, et elle a une signification explicite, volontairement explicitée par l’auteur qui en donne la clé, mettant côte à côte l’idée abstraite et son signe concret. Les allégories ne sont plus alors que des comparaisons, de simples « eikonès », des « images analogiques » que l’on ne peut, dès lors, assimiler à des mythes. L’allégorie n’expose pas une théorie de la connaissance, mais elle applique cette théorie. Donc, il y aurait une voie vers un possible salut.
Dans une vision philosophique plus classique, nous pouvons déterminer un certain nombre d’orientations. En premier lieu l’allégorie s’inscrit dans le symbole de la ligne qui représente les quatre genre d’objets connaissable dont se compose l’univers. L’allégorie tire de cette division les conséquences relatives à l’éducation. Les connaissances de l’ignorant se bornent aux deux premiers segments, les « horata » et les « doxata ». L’éducation nous élève jusqu’aux « noëta inférieurs » et seul le dialecticien peut atteindre les « noëta supérieurs ». Cette peinture de l’homme peut être rapprochée de l’homme sans culture et celle de l’homme éduqué, celle des hommes nourris dans les tribunaux et ceux qui sont nourris par la philosophie, que nous retrouvons dans le Théétète (172c-177c). Si nous convenons que la caverne est bien une allégorie, elle n’est ni une simple comparaison, comme la torpille du Ménon, ni une image au même titre que les cygnes d’Apollon dans Phédon, ni même une analogie comme la ligne proportionnelle du livre VI de la République. C’est un récit symbolique riche en interprétation diverses : la philosophe Geneviève Droz, le qualifie de « mythe allégorique ».
Il débute au commencement du livre VI de la République, avec en toile de fond la question capitale : a qui le gouvernement de l’État doit-il être confié ? Cela amène le philosophe à se poser un certain nombre de questions :

– l’essence politique est la création et le maintien d’une cité idéale juste. Vision en opposition que reprendra St. Augustin dans l’opposition entre « Jérusalem terrestre » et « Jérusalem céleste ».
– Cette cité harmonieuse est composée de trois classes à l’image des trois parties de l’âme et qui devra répondre à la triple exigence du travail (les producteurs), du dévouement au bien public (les gardiens), de la gestion rationnelle et sage (les philosophes et les magistrats).
– Les futurs dirigeants de la cité ne pouvant accéder à leur tâche qu’au terme d’une longue démarche intellectuelle et d’une rigoureuse éducation morale. Mais, chez Platon, il y a déjà sélection : en sont exclus les marchands de prophéties et d’exorcismes, l’artiste parce qu’il n’est qu’un imitateur, le travailleur manuel car englué dans la matière, le sophiste, et naturellement l’esclave.
Cette démarche exige le passage de l’ignorance à la connaissance, objet essentiel de l’éducation. Il se fait par degrés : ainsi, progressivement, l’intelligence ira-t-elle à la fois du plus illusoire au plus réel, du plus obscure au plus lumineux, les Idées étant elles-mêmes éclairées par la source de toute lumière, le Bien.
C’est alors que l’on passe de l’analogie à l’allégorie. L’analogie est statique et représentait les degrés de la connaissance correspondant aux degrés de l’être tandis que l’allégorie est dynamique et raconte l’histoire d’une ascension. L’analogie est explicative tandis que l’allégorie est didactique, elle donne une représentation concrète ou imagée qui est immédiatement compréhensible. Le récit de l’allégorie se déroule en quatre temps :
– Un descriptif de la caverne et de notre enchaînement : les hommes enchaînés sont à notre image, dans un monde artificiel des réalités que nous ne connaissons que par leur apparence, où l’illusion est totale, puisque depuis leur naissance les captifs confondent la réalité avec les simulacres. Mais cette situation sans responsabilité est somme toute confortable et représente un certain pouvoir que développera plus tard Hegel dans sa dialectique du maître et de l’esclave. Les captifs ne fonctionnent que par ouï-dire. Ils sont ignorants mais croient savoir, et plus encore que l’esclave qui se croit libre. Existe aussi un sens de la faute, dans Phèdre (246a-249b), dans la métaphore de « l’attelage ailé », Platon écrit à propos des âmes : « Ce jugement rendu, les uns se rendent aux prisons souterraines et y purgent leur peine, les autres vont quelque part dans le ciel, allégées par l’arrêt de justice, et vivent comme elles l’ont mérité par leur existence sous la forme humaine ». On peut supposer, chez Platon, l’existence d’un ciel et d’un enfer, ou supposer que la connaissance est un paradis et l’ignorance un enfer. Le feu dans la caverne serait l’illustration d’un « soleil trompeur », bien en-deçà de la lumière extérieure. Platon dénonce ici la suffisance de ses ennemis de toujours, les Sophistes, qui se vantent de voir la lumière, alors qu’ils ne voient que l’apparence, le faux-semblant.
– La « Periagogê », la conversion. Va apparaître dans cette séquence l’influence du « On » mystérieux, dont nous parlions précédemment, et à qui certains captifs vont obéir. Il les contraint à regarder les objets dont ils n’avaient jusque-là perçu les ombres. Est-il un dieu, un homme, ou une force intérieure qui les pousse à se dépasser en permanence ? C’est en tout cas un véritable arrachement de sortir de la caverne de la « doxa », de l’opinion superficielle. Cela suppose une conversion de tout l’être (Rappelons-nous que « convertere » signifie « se tourner tout entier ») qui amène à l’abandon de la nostalgie d’une passivité perdue et l’apprentissage d’un savoir qui amène l’accouchement des jugements personnels. C’est un passage du « on dit au je pense ». Il y a souvent une réaction brutale à l’éveil des sujets, allant parfois jusqu’au meurtre ou à l’exclusion du gêneur : « Ainsi parlait Zarathoustra » en est une belle démonstration !
– L’ « Anabasis » ou le long travail de l’ascension. Cette ascension vers la lumière suppose un travail constant d’apprentissage, particulièrement dans le domaine des sciences abstraites (géométrie, arithmétique, astronomie). Pour Platon, ce sont des sciences « éveilleuses et propédeutiques », et elles préparent à l’abstraction suprême, celle des Idées.

– La régression vers les ténèbres. Elle est conditionnée par la question : « Qu’est-ce que « Là-Haut ? ». Platon est prudent : en fait, il pense que, ici-bas, on ne peut atteindre la sagesse qui appartient aux dieux, ni la vérité que seules quelques âmes, non encore incarnées, ont eu le privilège de connaître autrefois. Le « Philodoxe », l’amoureux de l’opinion courante, est devenu un amoureux de la sagesse, mais nous savons que l’amour n’est que tension, désir et incertitude de sa réalisation. Cela signifie que l’ascension est permanente. De surcroît, celui qui approche de la lumière, tel Moïse, risque de se brûler les yeux, mais aurait aussi pour mission de redescendre, comme dans le Bouddhisme du « Grand Véhicule » ; éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres et donc renoncer au nirvana pour lui-même, comme les « Boddhisatvas », pour le salut de ceux qui sont détournés de la lumière. Geneviève Droz écrit (6) : « Tant d’autres, en-bas, vivent encore dans l’ignorance et le mensonge. Et comme si l’on n’avait pas le droit de conserver pour soi seul un bien, pourtant si durement conquis, comme si l’acquisition de la vérité n’avait de véritable sens que propagée et partagée, comme si le vrai lieu de la philosophie ne devait pas être là-haut, dans la majestueuse « plaine de la vérité », mais bien en-bas, là où se trouvent les hommes, leurs joies et leurs détresses, notre philosophie redescend. Piètre retour, où se mêlent aveuglément maladresse d’un côté, ricanements, sarcasmes, voire menaces et désir de meurtre de l’autre. Après tout, Socrate n’a-t-il pas lui-même été assassiné par les Athéniens, et tant d’autres persécutés par la bêtise et la suffisance de ceux qui ne veulent rien comprendre ? »
Si le monde sensible n’est que la grossière copie du monde intelligible, si la seule vérité est du côté des Idées, l’homme est l’habitant de deux mondes : il peut, à la fois, se satisfaire des illusions mensongères de la caverne, mais aussi en sortir afin de s’approcher d’une vérité qui n’est souvent que la sienne, en partant du principe que nous sommes bernés en permanence sans le savoir et que nous vivons dans le leurre, en toute insouciance et ignorance. La dialectique ascendante peut amener l’homme à la contemplation de l’intelligible dans la lumière de l’Idée du Bien (La République), comme l’amour peut permettre, au terme d’une lente gradation de saisir intuitivement la Beauté, c’est-à-dire l’Absolu du Beau dans sa divine et éternelle majesté (Le Banquet). Mais ceux, rares, qui atteignent le haut ne peuvent y demeurer : la quête de la vérité ne saurait se désolidariser du devoir. Ce que nous rappelle encore Geneviève Droz : « La philosophie n’est ni évasion, ni retranchement, ni rupture, ou elle ne l’est que le temps d’une ascension personnelle, elle est au contraire enracinement, prise en charge du monde et de l’histoire, investissement de soi dans la « commune demeure ». A ses risques et périls »…
Il est intéressant de constater qu’à la fin de la République (X, 617d-621b) Platon ré-utilise un mythe de résurrection d’Er le Pamphylien, du Léthé, de l’empire des morts, pour évoquer la réincarnation en fonction de la vie passée mais surtout pour évoquer la faiblesse constitutionnelle de l’homme qui ne peut se passer de guides : dans Phédon (81d-82b), il dit que les âmes qui ont pratiqué la tempérance et la justice par habitude, émigreront dans des espèces animales sociales ou dans le corps de braves-gens, mais que seules les âmes amies du savoir émigreront dans l’espèce divine. Ce n’est pas pour rien que ce mythe clôture la République, ouvrage consacré à la raison gouvernante, dominante et triomphante. Mais elle n’est pas seulement qu’une chance de salut pour la cité fragile : elle donne sens aux destins individuels. Le message de Platon s’y trouve condensé : il convient qu’en tout lieu du monde et qu’en tout temps, la pensée réfléchie règne en souveraine, dans la cité et les âmes. C’est le prix à payer pour le salut du cosmos. Mais nul n’est vertueux volontairement. Y a-t-il chez l’homme une violence naturelle, une méchanceté innée qui en fait une bête immonde faisant voler la société en éclats ? La question hantera Machiavel, Hobbes, Rousseau, Freud…Et aussi la Franc-Maçonnerie !
IV – Conclusion
La Franc-Maçonnerie, ô combien ! s’est inspirée de l’allégorie de la caverne dans ses rituels ou ses réflexions. L’idée commune est celle de l’ascension et elle emploiera le symbolisme de l’échelle pour illustrer la pensée platonicienne, bien que cette échelle ait plus à faire avec la théologie de Jean Clinmaque (579-649) qui nous conduit, théoriquement, à la grâce plutôt que la voie ascendante de Platon qui vise la formation de l’élite de la cité ! Cette allégorie de l’échelle peut nous faire songer également, dans une métaphore guerrière, aux échelles le long des remparts d’une ville à conquérir (La Jérusalem terrestre ?). Bernard de Clervaux le résumerait ainsi (7) : « Nous sommes ici comme des guerriers sous la tente, cherchant à conquérir le ciel par la violence, et l’existence de l’homme sur la terre est celle d’un soldat. Tant que nous poursuivons ce combat dans nos corps actuels, nous restons loin du Seigneur, c’est-à-dire de la lumière. Car Dieu est lumière ».. L’esprit maçonnique est contenu dans le renversement des perspectives, ces passages de relais, cette quête mutuelle du mystère et des correspondances, en utilisant un itinéraire spirituel s’étageant selon ce que, Bernard de Clervaux appelle une « échelle d’humilité » allant de la crainte à l’amour, en passant par l’obéissance, l’effacement volontaire, le silence. C’est, en fait, un programme pour rassembler les trois ordres de toute société : ceux qui combattent, ceux qui prient, ceux qui produisent. Le secret de la Jérusalem terrestre tient à une alchimie entre pouvoir et spiritualité, commandement et humilité, en oubliant pas la dimension du « silence de l’écoute » qui conduit à un type de communion et de communication qui s’instaure alors à l’égard d’autrui et à l’intérieur de soi-même, permettant d’accéder, de « clarté en clarté » à l’absolu et à son sens de l’universel. De cet « Unique nécessaire » viennent d’étranges lumières que les gnostiques appelaient « substances lumineuses » et que Jung assimilera aux archétypes, ces « luminosités germinales » qui luisent dans l’obscurité de l’inconscient. La réconciliation avec le monde se perçoit le plus souvent à-travers une sensation de lumière intérieure. D’ailleurs, William Blake disait : « Nous sommes mis sur terre un bref instant pour apprendre à supporter les éblouissants rayons de l’amour ». La Maçonnerie repose sur une dynamique d’unification qui apparaît comme un voyage sans retour sur une ligne de crête très étroite où le sens de l’équilibre est à reconquérir à chaque pas, avec le risque de chuter de l’échelle. Mais cela ne se borne pas à une imitation, un catéchisme. Il convient d’ajouter sa pierre à celles d’un édifice plus grand dont il se sent consciemment le bâtisseur, mais à son corps défendant, comme s’il ne faisait que répondre aux impulsions que le monde lui imprime. En Maçonnerie la circulation élévatoire du sens procède par intégration ascensionnelle des fonctions de l’âme. Existent trois mondes : sensibila, inteligibilla et intellectibilia, ainsi que trois niveaux de l’âme et trois relations de connaissance et d’amour avec ces trois mondes auxquels on accède qu’en étant particulièrement prédisposé et déterminé.

La Franc-Maçonnerie, en regard à l’allégorie de Platon, vit ce que nous pourrions appeler un « optimisme ascensionnel » qui n’est pas de mise pour l’auteur ! En effet, il y a une impérieuse obligation de retour dans la caverne pour les quelques courageux qui voulurent escalader le chemin vers la lumière : la quête personnelle de la vérité ne saurait se désolidariser du devoir, ingrat, de l’éducation de l’autre. Tant qu’à l’amour, l’autre n’a que la fonction de me faire accéder, de façon parcellaire ou changeante à la beauté qui est l’antichambre des Idées. Amour et connaissance ne sont que des moyens, jamais une finalité. S’ils ne sont pas dépassés, ils deviennent sans intérêt et sont à l’image de l’attelage ailé du Phèdre (246a-249b) : « Quand ils vont au festin, au banquet, ils gravissent l’escarpement qui mène à la voûte soutenant le ciel : dans cette montée, les attelages des dieux, équilibrés et faciles à conduire, progressent avec aisance, mais les autres, n’avancent qu’à grand peine, car le cheval qui est rétif tire vers le bas, faisant pencher le char vers la terre, et alourdissant la main du cocher qui n’a pas su le dresser. C’est alors que l’épreuve et le combat suprême attendent l’âme. Car celles des âmes qui sont dites immortelles, quand elles atteignent le sommet s’avancent au-dehors, se dressent sur le dos de la voûte céleste, et là, debout, se laissant emporter par la révolution circulaire, contemplent les réalités qui sont en dehors du ciel ».
L’autre, dans la vision platonicienne, dans l’amour et la connaissance va me servir à m’élever et mon choix va être d’opter pour le bon ou le mauvais cheval, ou éventuellement d’en changer, car seule compte mon illumination qui me conduit au monde des Idées ! L’autre est-il mon prochain ? Rien n’est moins sûr chez Platon… Le but est de faire accéder à la connaissance quelques rares personnes qui étaient dans l’ombre et de les faire redescendre pour y exercer le pouvoir de diriger ceux qui étaient, qui sont, qui veulent rester dans l’ombre. Le Maçon, lui, éclairé par son ascension, choisit de redescendre, par charité, dans le monde de la matérialité. Nous sommes donc dans l’opposition entre le monde du pouvoir et celui de la fraternité et l’opposition entre le monde laïc et celui de la spiritualité. Pour faire de l’humour, nous pourrions dire que Platon vise à la création d’une forme d’ « E.N.A. » alors que la Maçonnerie serait plutôt du côté d’un Institut philosophico-théologique ! En tout cas, la Maçonnerie choisit le logos au lieu du mythos. Elle n’a nullement à s’occuper de ce qui peut et doit être cru, elle se doit de discerner que ce qui se laisse savoir. Ce que traduit Arhur Schopenhauer quand il écrit dans son célèbre ouvrage, « Le monde comme volonté et comme représentation » (8) : « Nous ne sommes pas seulement le sujet qui connaît, mais que nous appartenons nous mêmes à la catégorie des choses à connaître, que nous sommes nous-mêmes la chose en soi, qu’en conséquence, si nous ne pouvons pas pénétrer du dehors jusqu’à l’être propre et intime des choses, une route, partant du dedans, nous reste ouverte : ce sera en quelque sorte une voie souterraine, une communication secrète qui, par une espèce de trahison, nous introduira tout d’un coup dans la forteresse, contre laquelle étaient venues échouer toutes les attaques dirigées du dehors… »
Il convient d’éviter la confusion entre cause et conséquence, et ce que nous dit Platon dans son allégorie est que la forme de la vie et de la réalité est le présent seul, non l’avenir, ni le passé : ceux-ci n’ont d’existence que comme notions, relativement à la connaissance, et parce qu’elle obéit au principe de raison suffisante. Jamais homme n’a vécu dans son passé, ni ne vivra dans son avenir, c’est le présent qui est la forme de toute vie. Pour Platon, nous ne sommes que des manifestations de l’Idée qui, apparaissent et disparaissent, pareils à des rêves instables.

Dans « Jacques le fataliste » Denis Diderot définit ainsi la place de l’homme : « Un château immense, au frontispice duquel on lisait : « je n’appartiens à personne, et j’appartiens à tout le monde : vous y étiez avant que d’y entrer, vous y serez encore quand vous en sortirez. » Tant que la crainte et la fatigue existent chez le sujet, il n’y a pas de bonheur durable ni repos, car la connaissance de l’Idée passe par la contemplation pure, le ravissement de l’intuition, la confusion entre sujet et objet, l’oubli de toute individualité. Dès lors, il est indifférent d’être dans la caverne ou dans un palais pour contempler le cosmos. La caverne devient alors nécessaire pour percevoir ce qu’il en est du faux-semblant et de la qualité de la vraie lumière comparée à la semi-obscurité. Jean de la Croix, dans « La nuit obscure » (9), nous explique fort bien la nécessité de la nuit pour mieux accueillir la lumière. Mais une question métaphysique, incessante chez Platon se pose : y aurait-il un « Dieu-artisan » vers qui je dirigerais mes pas à-travers l’obscurité ? Chez Platon, ce Dieu-artisan n’est nullement créateur et ne fait rien « ex-nihilo » : il ne fait qu’organiser une matière existante de toute éternité, en imitant un modèle existant, en fonction d’Idées et de nombres, déjà inscrits dans le monde intelligible. Le « Dieu-démiurge » n’est en aucun cas l’auteur de ce qui est : la matière, le modèle intelligible et l’artisan cohabitent de toute éternité (Timée 29c-30c). Chez Platon, la montée vers la lumière, contrairement à la Maçonnerie, n’autorise pas les chemins de traverse comme le sont les rituels, il faut être dans la ligne, l’ « orthé », la « pensée droite ». L’obéissance à un impératif catégorique est une sorte de leitmotiv de l’allégorie. Mais, au-delà de l’obéissance absolue prônée par Platon, le Franc-Maçon est plus sensible au message de Schopenhauer (10) : « Au contraire, le véritable et pur amour, et même la libre équité, procèdent déjà de l’intuition qui voit au-delà du principe d’individuation, laquelle, arrivée à son plus haut degré, conduit à la sainteté absolue et à la délivrance ; elle se manifeste par cet état particulier que nous avons décrit et qui est la résignation, par la paix profonde qui l’accompagne, par la béatitude infinie au sein même de la mort. »
Dès lors, il convient au Maçon, de faire prévaloir la vie sur le pourrissement et la plénitude sur la destruction…
Sacré chantier !
NOTES
– (1) Cheng François : Œil ouvert et cœur battant. Paris. Ed. Desclée de Brouwer. 2011. (page 48).
– (2) Romano Claude : Être soi-même. Paris. Ed. Gallimard. 2019. (page 61).
– (3) Brunschvicz Léon : Philosophe français (1869-1944). Enseignant à la Sorbonne, spécialiste de Kant et Hegel, mais aussi de Platon et Spinoza. Ses principaux ouvrages sont : « La modalité du jugement » (1897) ; « Les étapes de la philosophie mathématiques » (1912) ; « Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale » (1927) ; « La raison et la religion » (1939).
– (4) Quignard Pascal : La vie n’est pas une biographie. Paris. Ed.Galilée. 2019. (page 48).
– (5) Rank Otto : Le traumatisme de la naissance. Paris. Ed. Payot. 1976. (pages 176 et 177)
– (6) Droz Geneviève : Les mythes platoniciens. Paris. Ed. Du Seuil. 1992. (page 99).
– (7) Montagu Jean-Yves et Martel Olivier : L’âme cistercienne. Paris. Ed. Du Chêne. 1999. (page 12).
– (8) Rosset Clément : Schopenhauer. Paris. PUF. 1968. (pages 62 et 63).
– (9) Jean de la Croix : La nuit obscure. Paris. Les éditions du Cerf. 1992.
– (10) Schopenhauer : idem (page 102).
BIBLIOGRAPHIE
– Blondel Joseph : Les ombres de la caverne. Paris. Ed. Ellipses. 2001.
– Bonhner-Cante Marie-Hélène : Platon et la sexualité. Toulouse. Éd. Euop-Repress. 1981.
– Buttin Anne-Marie : La Grèce classique. Paris. Éd. Les Belles Lettres. 2000.
– Brisson Luc : Platon, les mots et les mythes. Paris. Éd. Maspéro. 1982.
– Brun Jean : Platon et l’Académie. Paris. PUF. 1979.
– Châtelet François : Platon. Paris. Éd. Gallimard. 1965.
– De Romilly Jacqueline : La Grèce antique à la découverte de la liberté. Paris. Éd.Biblio/Essai. 1989.
– Descombes Lucien : Le platonisme. Paris. PUF. 1971.
– Dixsout Monique : Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon. Paris. Éd. Vrin. 2001.
– Frutiger Perceval : Les mythes de Platon. Paris. Éd. Alcan. 1930.
– Jeannière Abel : Platon. Paris. Ed. Du Seuil. 1994.
– Lacan Jacques : Le transfert. Livre VIII. Le Séminaire. Paris. Éd. du Seuil. 2001.
– Platon : Oeuvres complètes. Paris. Ed. Flammarion. 2011.
– Rosset Clément : Schopenhauer, philosophe de l’absurde. Paris. PUF. 1967.
– Schul Pierre-Maxime : La fabulation platonicienne. Paris. Ed. Vrin. 1947
– Mazel Jacques : Socrate. Paris. Ed. Fayard. 1987.
– Vernant Jean-pierre : Mythe et société en Grèce ancienne. Paris. Éd. Maspéro. 1974.
– Vernant Jean-Pierre et Vidal-Naquet Pierre : La Grèce ancienne. Du mythe à la raison. Paris. Éd. du Seuil. 1990.
– Vernant Jean-Pierre : Mythe et pensée chez les Grecs. Paris. Éd. Maspero. 1954.


En somme, sortir de la caverne est inutile, il suffirait de se retourner du mur où sont projetées les ombres, pour se tourner vers soi et les autres. La verticalité n’est plus alors une ascendance mais une descendance (en soi) et l’horizontalité est fraternité et non hubris.