Lucrèce (90–53 av. J-C.) : « de la nature » comme hymne joyeux et admiratif au cosmos.
« Je ne suis pas un philosophe. Je ne crois pas assez à la raison pour croire à un système. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment il faut se conduire. Et plus précisément comment se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison »
(Albert Camus)
Six siècles avant Jésus-Christ des philosophes grecs découvraient que « ce qui est ne saurait ne pas être ». Ainsi en jugeait Parménide : l’Être est un absolu qui existe de toute éternité, mais que cela ne préjuge en rien des formes qu’il peut prendre. Il appartient à la fois à l’ordre de la matière et à celui de la pensée : « Ce qu’il est possible de penser, est identique à ce qui peut être » disait Parménide. Il en résulte que l’univers est connaissable puisqu’il est consubstantiel à la pensée humaine. Il ne peut avoir été créé de l’extérieur par aucune puissance, car cela supposerait l’existence de celle-ci, indépendamment de l’Être, ce qui serait absurde. Lucrèce écrit : « Aucune chose, jamais ne naît du néant par une action divine ». C’est le monde qui est divinisé et comprendre par la pensée la nature profonde des choses nous égale aux dieux. Connaître les lois des choses nous permet d’échapper à l’angoisse inhérente de la condition humaine plongée dans l’incertitude du devenir, soumise à la vacuité et à la disparition par la mort qui n’est chaque fois qu’une transformation de l’Être. Conséquence de la doctrine atomiste, imaginée pour résoudre la contradiction entre un Être plein et immobile et la réalité du mouvement et des changements qui surviennent dans le vécu des choses. Découvrir et reconnaître que notre existence individuelle n’est que relative à un certain état du monde, mais que notre pensée est capable de percevoir la totalité et l’éternité de l’Être remet, selon l’expression de Pascal, « le prix aux choses » et découvrir, dans chacun des instants de l’Être, la plénitude de celui-ci.

Chez Lucrèce, nous pouvons noter, cette permanence de l’intérêt à l’Être est supérieure à celle du plaisir chez son maître Épicure. Cela s’explique par le discrédit attaché par la mentalité romaine de la notion même de plaisir, à son époque, alors que le plaisir fut considéré, par le passé, comme le Bien suprême et la mobilisation dans les épisodes politiques que traversait Rome, le rendait comme un frein. Lucrèce n’ignorait pas que la notion de plaisir chez Épicure (qu’il appelait « ataraxie ») était bien différente de ce que les Latins nommaient « voluptas » et Lucrèce va préférer le terme « tranquillitas » pour évoquer le plaisir, retrouvant ainsi toute une tradition qui remontait à Démocrite, assimilant le calme intérieur à celui de la mer que n’agite aucune tempête. L’épicurisme devient alors la mise en forme d’une attitude de l’âme, et non l’addition de concepts comme dans le platonisme qui conduit l’initié, de degré en degré vers une vision exaltante de l’univers, alors que lui le met en présence de celui-ci et lui fait entrevoir le bonheur des dieux et ne déduit qu’ensuite les conditions qu’il doit remplir pour le retrouver… Avant Lucrèce existaient des poèmes cosmologiques depuis que les premiers philosophes avaient essayé de donner à l’univers une représentation cohérente, mais le « logos », le discours, succédait à l’ « epos », l’épopée. Un temps plus concerné au jeu des concepts abstraits qu’à une vision globale de l’Être. Cependant, demeurait dans les mémoires un poème cosmogonique : celui d’Empédocle le sicilien, qui donnait aux hommes une révélation plus mystique que discursive sur les lois de l’Être. Lucrèce s’est souvenu de cette œuvre étrange dans la composition « De la Nature ». D’autres noms vont être associés à la création poétique : Catulle, Virgile, Horace. Le temps devenait propice pour un poète moins préoccupé d’exposer un système scientifique ou rationnel que de rendre sensible ce qui permettait à l’âme humaine de renouveler son alliance avec les « choses » (une matérialité en soi, hors des dieux), et de parvenir ainsi à la sérénité.
I- TROUVER LA PAIX DANS LES REMOUS DE L’HISTOIRE.

Drôle d’époque que celle de Lucrèce ! Elle voit l’agonie de la République deux guerre civiles abominables dont il est le témoin. Né vers 90 av. J.-C, il mourut en 53, selon l’historien Pierre Grimal et assistera à la proscription de Marius (87) et de Sylla (82), à la revolte de Spartacus (73-71), au consulat de Cicéron et à la mort de Catilina (63-62), au premier Triumvirat (60) et à l’extension de l’empire romain vers le Proche-Orient. Nous ne possédons pas de documents biographiques sur la vie de Titus Lucretius Carus. Le seul document, très contestable, nous vient de Saint-Jérôme qui nous informerait que Lucrèce, victime d’un philtre d’amour, devenu à moitié fou, se serait suicidé ! Il fut surtout l’observateur d’un monde disloqué où scepticisme, épicurisme, stoïcisme constituent l’écho de la décadence de la République. Lucrèce, comme beaucoup de ses concitoyens, va chercher une philosophie qui permette de surnager dans un océan de violences. Découvrant Démocrite et surtout Épicure, il va se rallier aux philosophies atomistes en leur donnant, son interprétation personnelle, à-travers son poème didactique en six livres. Concernant Démocrite, laissons Diogène Laërce, doxographe du IIIe siècle ap. J.-C. nous en expliquer la teneur (1) : « A l’origine de toutes choses, il y a les atomes et le vide (tout le reste n’est que supposition). Les mondes sont illimités, engendrés et périssables. Rien ne naît du néant, ni ne retourne au néant. Les atomes sont illimités en grandeur et en nombre et ils sont emportés dans le tout en un tourbillon. Ainsi naissent tous les composés : le feu, l’air, l’eau, la terre. Car ce sont des ensembles d’atomes incorruptibles et fixes en raison de leur fermeté. Le soleil et la lune sont composés de masses semblables, lisses et rondes, tout comme l’âme qui ne se sépare pas de l’esprit. Nous voyons par des projections d’images, et tout se fait par nécessité, car le tourbillon est la cause universelle, et c’est ce tourbillon qui est le destin »
Mais c’est évidemment Épicure qui va rallier les suffrages de Lucrèce, jusqu’à en faire une sorte de Dieu, ou en tout cas le philosophe des philosophes, bien qu’il accomplît certains aménagements à la doctrine d’origine ! Épicure est né en 341 av. J.-C. Dans l’île de Samos, où son père, Néoclès, était maître d’école. Platon est mort depuis 6 ans et Aristote est devenu le précepteur du futur Alexandre le Grand. A 14 ans, Épicure, fut envoyé à Téos pour suivre les leçons de Nausiphane, disciple de Démocrite. Durant l’été de 306, il vient s’installer à Athènes avec plusieurs amis. Deux grandes philosophies de l’âge hellénistique vont voir le jour à Athènes : Épicure s’installe dans son fameux jardin en 306 et Zénon de Citium, fonde, en 301 l’école du Portique, « Stoa », d’où stoïcisme. Épicure mourut en 270, âgé de 71 ans. Son enseignement comprenait trois parties :
– La canonique qui était le fondement de la science et qui définissait les moyens d’approche du réel pour l’homme.
– La physique qui traite de la nature des choses. Pour lui la Nature est un donné purement matériel et n’a pas besoin de recourir à une explication surnaturelle.
– L’éthique qui enseigne ce qu’il faut éviter pour atteindre le bonheur.
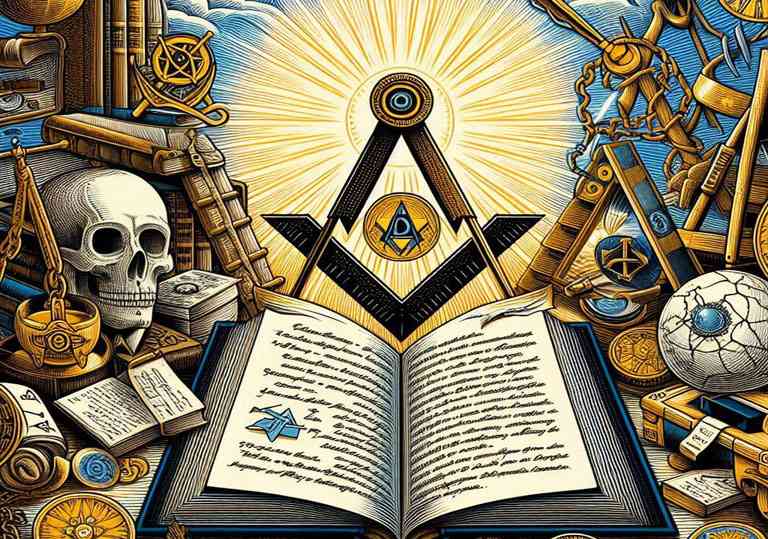
Le sage épicurien connaît un plaisir en repos caractérisé par la disparition de toute tension dans le désir. Il convient d’échapper à la fuite du temps par le souvenir ou l’anticipation. Le sage, cependant, cherche la satisfaction de ses désirs mais il distingue différentes sortes de désirs selon la célèbre « hiérarchie des désirs » d’Épicure : il y a les désirs vains (vouloir toujours plus) et les désirs conformes à la nature (qui sont bornés et nécessaires). Dans ce chapitre est aussi définie la différence entre l’amour et l’amitié : le sage doit éviter l’amour car il est impossible de se fondre dans l’autre et de ne faire qu’un avec lui. L’exigence d’exclusivité est incompatible avec le bonheur. En revanche, l’amitié, plus ouverte et moins débordante sera la marque du sage. Les épicuriens sont une petite communauté d’amis, préservant leur indépendance. Mais ces communautés mettaient un point d’honneur à rester fidèles à la pensée du Maître. Deux siècles après sa disparition on disait encore : « Agis toujours comme si Épicure te voyait » ! Presque de manière religieuse ou sectaire Lucrèce restera fidèle d’Epicure.
II- LA NATURE EST-ELLE UN ÊTRE ?
Ce sont dans les trois premiers livres de « De rerum Natura » que vont se définir les grandes problématiques de la pensée de Lucrèce en premier lieu, nous pouvons noter la présence permanente du principe féminin par deux hymnes dédiés à Vénus et à Cybèle, en l’honneur de deux génératrices de vie et sont des temps forts de l’hymne à l’univers. La Nature par définition est une mère qui donne naissance et vers qui tout retourne. Cependant, pour celui qui est inapte au bonheur, la nature met en place un mécanisme impitoyable : « Il n’y a rien d’autre à attendre de l’avenir que ce que tu as déjà connu dans le passé ». La durée n’est que la répétition incessante d’un même instant qui roule sur lui-même. Ce qui nous fait échapper à l’enfer de l’ennui de ce mécanisme est la relation avec les autres, aussi y tient-elle une plus grande place que la nature biologique. Cette fraternité de la forme humaine vient du fait que les mourants ont le même âge, du fait de la permanence de la mort, avec la dérive parfois de penser ce qui n’est pas, d’aller au-delà du réel, de porter en soi une aspiration à l’infini, ce qui mène à une éternelle insatisfaction. Il faut donc renoncer à ce « péché originel » de l’imaginaire et discipliner son esprit afin qu’il cesse de lâcher la proie pour l’ombre. L’homme souffre d’un divorce entre corps et esprit, et pour Lucrèce, c’est le corps qui a raison, car c’est lui qui doit affronter la mort, et donc l’esprit dont le corps était porteur, disparaît. Contrairement à Épicure, Lucrèce parle de la Nature comme d’une maîtresse sévère et non comme d’une mère : au désir de vivre, elle répond par la nécessité de la mort. L’orientation matricielle est pondérée par le fait que la Nature est « la mère de toutes choses et leur commun tombeau » Ce que Montaigne résume dans un message commun à l’épicurisme et au stoïcisme : « Philosopher c’est apprendre à mourir ». Dans son poème « Océan », Victor Hugo saluera le visionnaire, mais condamnera le désespéré :
Lucrèce,
spectateur de l’infini hideux.
Il pense, il songe, il cherche, il sonde l’insondable,
Avec un penchement de tête formidable ;
La nature l’emplit de son vaste frisson ;
Son poème est un morne et livide horizon ;
On entend dans son vers les spectres qui s’appellent.
Les écailles de l’ombre et de l’onde se mêlent
Dans son rythme sinistre où par moment reluit
Le vague gonflement des hydres de la nuit…

Face à la lucidité d’un pareil destin, il convient que l’homme trouve et vive une recherche et une conception du bonheur. Quels en sont les ingrédients que Lucrèce nous propose ?
La sérénité est le premier point de la félicité et s’obtient par la satisfaction des plaisirs sous réserve que ceux-ci s’inscrivent dans la sobriété. L’adjectif « serenus », en latin, suggérant à la fois le calme et la pureté. Elle se donne, en premier lieu, par la distanciation : « Il est doux, quand sur la grande mer les vents soulèvent les flots, d’assister de la terre aux dures épreuves d’autrui : non que la souffrance de personne nous soit un plaisir si grand mais voir à quels maux on échappe soi-même est chose douce. Il est doux encore de regarder les grandes batailles de la guerre, rangées parmi les plaines, sans prendre sa part du danger. Mais rien n’est plus doux que d’occuper les hauts lieux fortifiés par la science des sages, régions sereines d’où l’on peut abaisser ses regards sur les autres hommes, les voir errer de toutes parts et chercher au hasard le chemin de la vie, rivaliser de génie, se disputer la gloire de la naissance, nuit et jour s’efforcer, par un labeur sans égal, de s’élever au comble des richesses ou de s’emparer du pouvoir » (II, V. 1-13). Les sages constituent ainsi une forme d’élite liés par les mêmes croyances et qui ont plaisir à se retrouver par amitié, cette dernière n’étant pas simplement humaine mais aussi philosophique, et les séparant du commun des mortels : « Ô misérables esprit des hommes, ô coeurs aveugles ! Dans qu’elles ténèbres et dans quels dangers s’écoule ce peu d’instants qu’est la vie ! Ne voyez-vous pas ce que crie la nature ? Réclame-t-elle autre chose que pour le corps l’absence de douleur, et pour l’esprit un sentiment de bien-être, dépourvu d’inquiétude et de crainte ? » (II, V. 16-19).
La sérénité s’obtient aussi par la purification des passions en invitant les hommes à se libérer des vaines espérances et des désirs superflus en leur montrant que leurs ennemis sont à l’intérieur d’eux-mêmes. La crainte des dieux et celle de la mort sont à bannir. Concernant les dieux, il doute de leur existence devant la pluralité des mondes infinis : « Qui pourrait tenir d’une main assez ferme les fortes rênes capables de gouverner l’infini ? Qui donc pourrait faire tourner de concert tous les cieux, échauffer des feux de l’éther toutes les terres fertilisées, en tous lieux, en tout temps se trouver toujours prêt, pour faire les ténèbres avec les nuages, pour ébranler du tonnerre les espaces sereins du ciel, lancer la foudre… (II, V. 1095-1101). La connaissance scientifique va s’intensifier chez Épicure et Lucrèce, afin de donner une finalité morale : dissiper la crainte des dieux et celle de la mort qui obscurcissent la vision du vrai bien et empêchent l’homme d’atteindre le Plaisir pur et la Félicité. En fait, de parvenir à la lumière, à l’accession « in dias luminis ora », aux rivages divins de la luminosité. Denis Diderot déclarera : « Il n’est qu’un devoir, c’est d’être heureux » ! Pour Lucrèce, le plaisir (« Voluptas ») est une voie pour conduire l’homme à la Félicité du bonheur. Mais nous devons connaître la terre dont l’homme est le miroir, « C’est ainsi que la terre n’est pas une étrangère » (V.546). D’ailleurs, le mot « Natura » vient de la racine sanskrite « g’n » qui signifie naître, engendrer et amène l’idée d’une incontestable parenté. Lucrèce devient ainsi un poète de l’origine. ; origine du monde, du langage, de l’écriture, de la musique et de la poésie.

Mais toute cette réflexion, va s’appuyer chez Lucrèce sur le renforcement de la théorie de l’atomisme ; développée par Épicure. Il repart, pour cela, de deux principes fondamentaux : rien ne naît de rien et rien ne périt complètement. Il en conclut que c’est au moyen de ces corps invisibles, insécables, ou atomes que la nature accomplit son œuvre de modelage du vivant, le temps n’ayant pas d’existence en soi. Le plus petit corps est aussi complexe que l’univers lui-même et ce plus petit corps est l’atome. Les atomes ne sont jamais au repos puisque rien ne borne l’univers qui se trouve dans le vide infini. Les uns s’agglomèrent et forment des combinaisons, d’autres errent libres dans le vide en opérant parfois une déclinaison aléatoire, le « clinamen » dans lequel réside le principe de la liberté dont jouissent sur terre les êtres vivants : la faculté que nous avons d’aller où bon nous semble ou de résister à ce qui nous contraint prend sa source dans l’atome même. Les atomes sont infinis et n’ont pas tous la même forme et les corps se constituent à la suite de la rencontre des rencontres fortuites du clinamen, cependant ils ne peuvent se combiner entre eux de toutes les façons car les êtres vivants se répartissent en espèces définies et les choses inanimées sont elles-mêmes soumises à ces lois. Les atomes ne ressentent rien et l’univers ne dépend que de lui-même : aucun dieu ne pourrait gouverner le grand « TOUT », aucun ne pourrait contrôler les forces de la nature.
Lucrèce, dans son poème, va développer aussi la notion d’âme. Pour lui, l’âme réside dans le corps sous la forme d’un souffle vital dont la perte accompagne la mort. Esprit et âme sont faits d’une même substance, mais c’est de l’esprit plus que de l’âme que dépendent la vie ou la mort : il est le principe vital au centre de l’homme. L’âme est vulnérable et peut-être endommagée à l’intérieur du corps par des atteintes pathologique. Elle quitte progressivement le corps durant l’agonie et elle n’est pas immortelle et la mort signifie la dispersion totale de l’être, ce qui fait écrire à Albert Jacquard (2) : « Pourquoi ne pas réintégrer le pouvoir de penser au sein du pouvoir de vivre, comme la capacité à vivre peut-être ramenée à la capacité d’être ? Nous sommes tout entiers, corps et âme, des produits de l’univers ; en l’acceptant, nous ne nous enlevons aucune dignité. Nous donnons à l’univers une immense dignité ». En fait, cette intégration de l’âme dans l’éternité mouvante de la Nature n’amène t-elle pas Lucrèce à la création d’une forme de théologie où les dieux seraient paradoxalement exclus ?
III- IL Y A MATIERE A EN PARLER !

Dans son célèbre ouvrage (3) Sylvain Maréchal écrit à propos de Lucrèce : « Lucrèce chante l’athéisme ; il le réduit en système et cherche à l’embellir des charmes de la poésie : tout le monde applaudit à ses beaux vers. Il les dédie à son ami Memnius, sans que personne lui en fasse un crime : on ne persécuta ni l’auteur ni l’ouvrage parce qu’on sait que la liberté publique repose sur la liberté de pensée (Milton) ». Cette approche de Lucrèce mérite quelques nuances : évoquer Le poète, il y a quelques années, vous mettait d’emblée dans le camp du matérialisme, de l’athéisme ou de l’irréligion, alors que, en réalité, Lucrèce bâtit une théologie qui a pour but de mener à une connaissance du monde et de l’homme et à la pratique d’une éthique, sinon à un art de vivre fondé sur une contemplation presque mystique de l’univers. Cependant, il convient de ne pas oublier que tout au long du « De rerum natura », et en particulier dans les chants 1 à 3, Lucrèce ne cesse d’affirmer :
– Que les dieux se désintéressent totalement d’un monde auquel ils n’ont pas participé à la création ;
– Que toute religion et tout acte de culte, par voie de conséquence, sont parfaitement absurdes. Le but principal de Lucrèce est d’affranchir l’homme de la crainte des dieux et de dépasser l’image paralysante qu’il existerait un paradis ou des enfers.
La pensée de Lucrèce repose sur l’adoption de l’atomisme dont le concepteur en fut Démocrite d’Abdère (460-370 av. J.-C.) qui pense que la matière est divisible, non pas à l’infini, mais jusqu’à une certaine limite qui est précisément l’atome, c’est à dire l’insécable, le non-divisible, élément primordial de toute réalité matérielle et spirituelle. Quant à Épicure (341-270 av. J.-C), figure centrale de la pensée de Lucrèce, il enseigne que les atomes tombent dans le vide, non verticalement, mais certains selon une certaine obliquité dite « clinamen » et c’est ainsi que, de façon tout à fait imprévisible, les atomes se rencontrent et s’accrochent et forment le monde évolutif des formes pris dans un transformisme incessant. Rien n’a été ni voulu, ni projeté, ni créé. Tout ce qui existe est l’oeuvre du hasard et de la nécessité, comme le pense Jacques Monod.
L’Antiquité a peut-être ignoré le concept d’athéisme au sens que nous lui donnons aujourd’hui pour le remplacer par le mot « Eidola » pour caractériser les dieux : pour certains philosophes, ils ne sont que des images, des « simulacres », qui vivent dans des zones mal définies de l’espace qu’Epicure appelle des « intermondes », sans s’inquiéter des hommes ni des choses qu’ils n’ont nullement créés et dont le destin ne leur incombe pas. Ils se désintéressent totalement de l’homme : les réussites ou les échecs de ce dernier n’ont pas de sens et ne sauraient avoir valeur de récompenses ou de châtiments. L’âme étant mortelle se dissipe en atome avec la mort. Il n’y a aucune survie et l’homme n’a rien à redouter du « ciel » ou des « enfers » qui n’existent pas. Pour Lucrèce, tout acte de culte est une folie et une sottise et il remplace la piété par le pouvoir à tout regarder d’un esprit que rien ne trouble, découvrant en permanence la beauté du monde. Puisque aucune règle de conduite ne s’impose, que les dieux ne sont ni auteurs ni gardiens ni cautions d’aucune morale, l’homme, maître de son destin, doit se choisir une ligne de conduite. Pour la première fois dans l’histoire antique, l’homme est confronté au problème de sa liberté. Concept qui sera reprit par Jean-Paul Sartre dans l’impératif pour l’homme de se choisir « Solus et ipse », seul et lui-même.

Cela nous amène à nous poser la question du « Souverain Bien » chez Lucrèce : comme chez son Maître Épicure, le Souverain Bien est le plaisir bien que sa morale soit moins sévère que le maître du jardin. Mais il reste intransigeant sur le fait que supprimer la religion, c’est supprimer le mal. Il écrit : « L’amour des richesses, l’aveugle désir des honneurs qui poussent les misérables hommes à transgresser les limites du droit, parfois même à se faire complices et les serviteurs du crime… C’est pour la plus grande part la crainte de la mort qui les nourrit. Non minimam partem mortis formidine aluntur. (Chant III, v. 59-64). En fait, Lucrèce, plus que de constituer une morale, veut édifier une sagesse, tellement recherchée par les philosophes de l’Antiquité, la fameuse « Tranquillitas animi », la paix de l’âme, qui permet de vivre avec un recul qui met à l’écart ceux qui y parviennent : « Rien n’est plus doux que d’occuper solidement les hauts lieux fortifiés par la science des sages, régions sereines d’où l’on peut abaisser ses regards sur les autres hommes, les voir errer de toutes parts et chercher au hasard le chemin de la vie. (Chant II, v. 7-10). Le bonheur réside dans la modération, laquelle consiste à s’imposer une mesure (modus) à ses sentiments, désirs et actes, ceci pour éviter toute « turbulence ». Cette sagesse porte aussi ses fruits dans l’éloignement de la peur de la mort dont Lucrèce affirme qu’elle n’est rien de plus qu’une dissolution générale de l’être par la désagrégation et la dispersion totale des atomes qui composent aussi bien l’âme que le corps qui rejoignent l’Être, le Grand Tout. La vision de Lucrèce devient mystique à certains moments et rejoint la pensée de Blaise Pascal dans la recherche de cette Force Unique porteuse et créatrice de vie. A la différence toutefois que Pascal met un Dieu créateur à la base de sa réflexion : « Je sais seulement qu’en sortant de ce monde, je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions, je dois être éternellement en partage » (Pensées, section III, 194). Nous retrouverons aussi chez Pierre Teilhard de Chardin cette forme d’admiration quasi religieuse du cosmos et cette sorte d’ivresse de l’esprit qu’il partage avec Lucrèce. Nous retrouvons aussi chez des scientifiques ce parallélisme avec l’auteur de rerum Natura. Par exemple Jacques Monod qui envisage une éthique et peut-être même un art de vivre fondés sur la seule connaissance scientifique (4) : « C’est peut-être une utopie, mais ce n’est pas un rêve incohérent…L’ancienne alliance est rompue : l’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. A lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres »…
Les théoriciens de l’anarchie vont naturellement puiser chez Lucrèce le « Ni Dieu, ni maître » de leur fondement ! Placée sous le signe double de l’éternel et du passager, chaque « circonstance » singulière et individuelle provient donc au plus bas, du gouffre de l’entropie maximale, au plus proche du tourbillon qui lui donne naissance et la précipite enfin dans le gouffre. Entre hasard absolu et nécessité inflexible du retour et de la disparition, « l’écoulement tourbillonnaire sauve le maintenant ». Dès lors, la connaissance devient le miroir du monde.
IV- ECLAIRER CE QUI DEMEURE DANS L’OMBRE ET CHEMINER VERS LA PENSEE LIBRE ET FINALEMENT VERS LA LIBRE-PENSEE.

Ces concepts vont donner tout un champ d’investigations en matière de psychologie des profondeurs. Pour Épicure, l’humanité est la proie de maladies physiques, mais aussi mentales et que nous retrouvons dans le « Tetrapharmakos », exposé par Philodème au 1er siècle avant J.C. A l’origine un onguent qui va se transformer en orientation philosophique, en « ingrédients » pour que chacun puisse atteindre le plaisir. Épicure écrit (5) : « Qu’on ait seulement sous la main ce quadruple remède : Dieu n’est pas à craindre, la mort est privée, le bien est facile à se procurer, la souffrance est facile à supporter ». Naturellement, Lucrèce va marcher dans les traces de son maître et insister sur le fait que le tétrapharmakos est surtout là pour délivrer l’homme de la crainte des dieux et celle de la mort en éloignant les « fables divines ». La figure d’un père tout-puissant, castrateur, s’éloigne ainsi du sujet et est remplacé par la figure féminine de Vénus dès le premier chapitre : cette divinisation de la nature comme image du principe féminin, créé une orientation parfaitement révolutionnaire dans la pensée antique. Le sujet sortant de la mère-nature y retourne à sa mort et renaît dans une nouvelle forme. En fait, Lucrèce nous dit que l’homme est déjà dans l’éternité et qu’il n’a rien à faire pour l’atteindre et ce, dans un mouvement ou Eros triomphe de Thanatos. C’est la peur de la mort et la disparition narcissique, l’ « aphanisis » qui pousse le sujet aux « divertissements » pascaliens : le pouvoir, l’argent, une sexualité débridée ne sont pas recherchés pour eux-mêmes, mais pour parer à une angoisse profonde. L’équilibre consiste à se suffire à soi-même et ne dépendre de rien ni de personne en limitant ses désirs. Orientations que Freud développera dans son « Malaise dans la civilisation » et « l’avenir d’une illusion » (6). Il découvre aussi que le plaisir est la fin de la tension négative dans la décharge et que l’ataraxie est le summum du bonheur, là où le sujet et l’objet extérieur ne font plus qu’un dans un moment provisoire où ils se rencontrent. Moment que nous rappelle la psychanalyste Gisela Pankov quand elle le cite dans son ouvrage sur un article publié en anglais, en 1927, sous le titre « The Ego and the Id » (7) : « C’est-à-dire que le moi dérive, en fin de compte, de sensations corporelles, principalement de celles qui surgissent à partir de la surface du corps. Il peut alors être tenu pour une projection mentale de la surface du corps, qui en outre, ainsi que nous l’avons vu, représente la superficie de l’appareil mental ». Vision qui sera reprise par Didier Anzieu dans son « Moi-peau ». Pour Freud, le Moi est d’abord et surtout un Moi corporel ; non seulement il est une entité de surface, mais il est lui-même encore la projection d’une surface. Il rejoignait là la pensée matérialiste de Lucrèce.
Mais, c’est dans le domaine de la philosophie que Lucrèce va laisser le plus de traces, principalement dans le grand courant libertin avec Gassendi, Cyrano de Bergerac, Molière et Diderot. Dès le XVIe siècle, l’influence des atomistes de l’Antiquité se firent sentir dans certains cercles intellectuels, notamment dans la lutte qu’ils entreprenaient contre la philosophie d’Aristote qui avait occupé la place durant une éternité. Cette dernière affirmait la prédominance de la forme sur les idées (Orientation platonicienne) et avait promu une certaine volonté de connaissance des lois physiques que ne reniera pas Lucrèce, bien qu’il en réfutât la théorie de l’inertie de la matière, lui qui la juge en mouvement permanent et créateur. De plus, durant des siècles, l’Église catholique avait fait sienne la pensée d’Aristote en l’asservissant aux dogmes du christianisme. En même temps avait lieu une formidable révolution scientifique : Copernic meurt en 1543, Gallilé mourra en 1642, Kepler et Tycho Brahé tracent le chemin de Newton. Et surtout, nous assistons à la séparation de la philosophie et de la religion. L’Église va réagir : le panthéisme Giordano Bruno est condamné et brûlé en 1600, ainsi que le matérialiste Vanini en 1619. Le nom de Campanella restera aussi dans le souvenir des victimes de la répression pour les libres-penseurs français.

Bientôt d’autres personnalités vont surgir dans le champ des concepts lucrétien. Par exemple Pierre Gassendi (1592-1655) qui écrit (8) : « Tous les libertins conviennent entre eux que les plus grands législateurs ne se sont servis de l’opinion vulgaire sur ce sujet (l’immortalité de l’âme), laquelle ils ont non seulement fomentée mais accrue de toute leur puissance, que pour emboucher de ce mors le sot peuple… ». Le nombre des libres-penseurs va s’accroître : Naudé, La Mothe Le Vayer, Cyrano de Bergerac qui va écrire son brûlot blasphémateur et satirique « L’Autre Monde ou les Etats et Empires de la lune ». Ce qui est prôné par les libertins du 17e siècle relève d’une économie des passions et d’un détachement aux valeurs fausses et matérielles du monde. Au XVIIIe siècle, une véritable rupture politique va s’opérer entre les libres-penseurs et la monarchie, ainsi qu’avec l’Église catholique qui la soutient. Philosophes et libertins vont se retrouver côte à côte dans ce travail de sape entrepris au nom de la raison contre la puissance des clercs et des églises. Pourtant, entre philosophes et libertins, existent des divergences en matière de morale, selon qu’existe une référence ou non à l’atomisme. Par exemple, Denis Diderot, matérialiste convaincu, adopte dans ses fameuses « lettres à Sophie Volland » un ton typiquement « lucrétien » quand il écrit, le 15 octobre 1759 (9) : « Ceux qui se sont aimés pendant leur vie et qui se font inhumer l’un à côté de l’autre ne sont peut-être pas si fous qu’on pense. Peut-être leurs cendres se pressent, se mêlent et s’unissent. Que sais-je ? Peut-être n’ont-elles pas perdu tout sentiment, toute mémoire de leur premier état. Peut-être ont-elles un reste de chaleur et de vie dont elles jouissent à leur manière au font de l’urne froide qui les renferme. Nous jugeons de la vie des éléments par la vie des masses grossières. Peut-être sont-ce des choses bien diverses. On croit qu’il n’y a qu’un polype ; et pourquoi la nature entière ne serait-elle pas du même ordre ? Lorsque le polype est divisé en cent mille parties, l’animal primitif et générateur n’est plus, mais tous ses principes sont vivants. O ma Sophie, il me resterait donc un espoir de vous toucher, de vous sentir, de vous aimer, de vous chercher, de m’unir, de me confondre avec vous, quand nous ne serons plus. S’il y avait dans nos principes une loi d’affinité, s’il nous était réservé de composer un être commun ; si je devais dans la suite des siècles refaire un tout avec vous ; si les molécules de votre amant dissous venaient à s’agiter, à se mouvoir et à rechercher les vôtres éparses dans la nature ! Laissez-moi cette chimère. Elle m’est douce. Elle m’assurerait l’éternité en vous et avec vous… ». Etrange envolée lyrico-mystique d’un athée ! De Lucrèce à Voltaire, il n’y a qu’un élargissement d’un combat, entrepris 18 siècles plus tôt par un insoumis, silencieux et poète. N’oublions pas aussi que la thèse de doctorat du jeune Karl Marx, en 1841, portait pour titre : « Différence de la philosophie de la Nature chez Démocrite et Epicure » !
L’oeuvre de Lucrèce est celle d’un trouble-fête, ce que nous rappelle, avec humour, Jean-François Peyret, enseignant et metteur en scène (10) : « Les bien-pensants, passés, actuels, de toujours n’aiment pas Lucrèce. Il commence à mettre les Dieux (Dieu) en chômage technique ; ah ! Il n’est pas, je sais bien, véritablement athée ; il pense que les dieux existent quelque part au-dessus de nous mais ils sont complètement indifférents à nos affaires et, pire encore, à nos prières. Ils se foutent de nous et de nos petites misères ; ils sont heureux, les Dieux. Ils baignent dans le plaisir, donc ils sont des sages ; c’est même pour cela que Lucrèce n’a pas intérêt à s’en débarrasser : ils sont un modèle pour les hommes ; ils sont l’idéal du sage. Mais pour le cours de l’univers, de la nature des choses, ils ne sont pas plus nécessaires que des joueurs de quilles ». Lucrèce donne une gifle à la gloriole de l’humanité et remet l’homme, « petit paquet de matière et de vide », à sa place dans la nature. Il ne lui fait plus l’honneur d’en faire le portrait de maître et possesseur de celle-ci. L’homme est nature, ce par quoi la nature se connaît elle-même.
Cependant, efforçons-nous de croire qu’il existerait une permanence de l’émerveillement et de la découverte du monde, comme le dit le poète et peintre britannique William Blake :
Voir un monde dans un grain
de sable
Et un ciel dans une fleur sauvage
Tenir l’infini dans la paume
de la main
Et l’éternité dans une heure.
Notre recherche permanente et notre prise de conscience est que, comme tous les êtres de la création, un courant de Vie unique coulerait sans cesse vers nous et à travers nous et cette prise de conscience là deviendrait gratitude…
NOTES
(1) Voilquin Jean : Les penseurs Grecs avant Socrate. Paris. Ed. Garnier-Flammarion. 1964. (Page 193).
(2) Jacquard Albert : idées reçues. Paris. Ed. Flammarion. 1989. (Page 180).
(3) Maréchal Sylvain : Dictionnaire des athées. Suivi de culte et lois d’une société d’hommes sans dieu. Paris. Ed. Coda. 2008. (Pages 181-182).
(4) Monod Jacques : Le hasard et la nécessité. Paris. Ed. Du Seuil 1970.
(5) Épicure : Doctrine et maximes. Paris. Ed. M. Solovine, Hermann. 1965. (Page 151).
(6) Freud Sigmund : L’avenir d’une illusion. Paris. PUF. 1971 et Malaise dans la civilisation. Paris. PUF. 1971.
(7) Pankov Gisela : Structure familiale et psychose. Paris. Ed. Aubier et Montaigne. 1977. (Page 31).
(8) Gassendi Pierre : Recherches métaphysiques. Paris. Ed.Vrin. 1962. (Page 334).
(9) Diderot Denis : Lettres à Sophie Volland. Paris. Ed. Gallimard. 1984. (Pages 90 et 91)
(10) Peyret Jean-François : A propos du spectacle de la Nature des Choses, in Lucrèce. Paris. Ed. Ellipses. 1990. (Page 110).
BIBLIOGRAPHIE
– Bloch Olivier René : La philosophie de Gassendi. Nominalisme, matérialisme et métaphysique. La Haye. Martinus Nijhoff. 1971.
– Boyancé Pierre : Lucrèce et l’épicurisme. Paris. PUF. 1963.
– Cyrano de Bergerac : L’autre Monde ou les Estats et Empires de la lune. Paris. Librairie Nizet. 1977.
– De Viau Théophile : Oeuvres poétiques. Paris. Librairie Droz. 1958.
– Épicure : Lettres et Maximes. Paris. PUF. 1987.
– Erlanger Philippe : Ninon de Lenclos. Paris. Ed. Perrin. 1985.
– Gassendi Pierre : Vie et mœurs d’Epicure. (2 tomes). Paris. Ed. Les Belles Lettres. 2006.
– Lucrèce : De la Nature. Paris. Ed.Belles Lettres. 1985.
– Mongredien Georges : Cyrano de Bergerac. Paris. Ed.Berger-Levrault. 1964.
– Nagy Péter : Libertinage et révolution. Paris. Ed. Gallimard. 1975.
– Ouvrage collectif : Analyses et réflexions sur Lucrèce. Paris. Ed. Ellipses. 1990.
– Ouvrage collectif : Théophile de Viau. Actes du colloque CMRM 17. Paris. Biblio 17. 1991.
– Ouvrage collectif : Les Epicuriens. Paris. Ed. Gallimard/ Bibliothèque de la Pleiade. 2010.
– Pintard René : Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle. Paris. Ed. Slatkine. 1983.
– Rodis-Lewis Geneviève : Épicure et son école. Paris. Ed. Gallimard. 1975.
– Russel Bertrand : Histoire de la philosophie occidentale. Paris. Ed. Gallimard. 1952.
– Serres Michel : La naissance de la physique dans le texte de Lutèce. Paris. Ed. De Minuit. 1977.


Ce qui me stupéfie depuis toujours, en lisant les auteurs antiques (et même jusqu »à la Renaissance), c’est qu’ils ont émis des hyypothèses, ou plutôt affirmeé, des vérités éternelles qu’ils n’avaient pas la moindre possibilité de constater ni de vérifier.
Relisons dans cet article ce qu’écrivait Démocrite. Il allait encore plus loin que le conceptin de l’atome de matière tel que nous la connaissons aujourd’hui, mais il décrivait l’espace insécable ultime, que nous appellons… le mur de Planck (1.10 puissance-35 et des poussières). Tout ceci prouvé… au début du XXème siècle.
Giodano Bruno affirmait que notre Univers était composé de multiples « univers-îles », nos galaxies, alors que jusqu’en 1920 (oui !) on pensait que ces taches vues dans le ciel était des « nébuleuses » (des nuages de poussières).
Quant à Denis Diderot (à relire aussi dans cet article), il ne croyait pas si bin raisonner en pensant que ses cendres et celles de son aimée pourraient se rejoindre et communiquer ! Une expérience (refaite deux fois tellement elle est incroyable) a montré que… le photon, particule élémentaire, avait une conscience ! (un physicien français donnait, lui, lélectron conscient !)
Devant de tels faits, j’ai développé dans mon ouvrage « les énigmes de la conscience » Frison-Roche éditeur, 2018, l’image d’un champ de conscience dans lequel baigne tout l’univers, et que nous ne faisons qu’y plonger pour y acquérir nos sensations et pensées.
Michel-Yves BOLLORE; Olivier BONNASSIES
DIEU, LA SCIENCE LES PREUVES
et
Matthieu 11:25
Allez sur mon blog http://www.rene-mettey.fr pour ma critique du livre de Bolloré et Bonnassies.
Cette oeuvre, très estimable par ailleurs, encyclopédique, ne convaincra personne ni dans un sens, ni dans l’autre (sauf, je l’écris, ceux qui penchaient déjà d’un côté), car la Science ne peut et ne pourra jamais prouver ni improuver l’existence ni l’inexistence d’un Dieu, quelle qu’en soit la définition*. La Science, c à d la pensée rationnelle, et la perception d’un principe supérieur absolu, sont de deux domaines différents qui ne se recouvrent pas. Essayez de labourer la mer !
*un physicien disait « je veux bien que Dieu, ce soit l’énergie, mais il nous faut nous prosterner devant un morceau de charbon! » (et j’ajoute dans mon livre « les énigmes de la conscience » : « et les centrales nucléaires sont ses temples »