Rompre le Cycle de Jak Bazino se présente comme une vaste traversée à double respiration, une narration tendue entre 1942 et 2024, où deux guerres, deux générations et deux quêtes se répondent jusqu’à faire apparaître, derrière l’intrigue, une méditation plus vaste sur la répétition du mal et la possibilité, rare et coûteuse, d’une sortie.

Ce qui saisit d’emblée, ce n’est pas seulement la matière historique, ni même l’âpreté des situations, c’est la manière dont Jak Bazino choisit d’installer la fatalité comme une mécanique intime, presque une écriture du destin dans la chair des personnages. La loi de causes à effets est formulée dans le texte avec une netteté qui fait plus qu’expliquer, elle tranche et relie en même temps, comme une ligne tirée sur l’ombre. Le karma devient un trait reliant des points minuscules, si minuscules qu’ils auraient pu passer pour des détails sans importance, jusqu’à ce qu’ils se révèlent comme l’armature secrète d’une vie. Et cette armature n’est pas abstraite, elle se vit dans un corps qui chute, dans un souffle qui manque, dans une décision qui revient hanter. Le roman ose écrire que les mêmes causes produisent inlassablement les mêmes effets, et que cette répétition ressemble à une pièce rejouée acte après acte, farce pour ceux qui applaudissent parce qu’ils n’ont pas appris à voir. Ce n’est pas une simple idée, c’est un diagnostic spirituel qui touche à notre propre époque, à nos propres enthousiasmes, à notre manière d’acclamer ce qui nous écrase parce que nous confondons mouvement et liberté.
Dans cette perspective, la guerre n’est pas un décor
La guerre devient la forme extérieure d’un enfermement intérieur, le théâtre d’une répétition dont les peuples paient le prix lorsque les héritages se changent en poisons et que les récits de légitimité, religieux ou politiques, reviennent servir d’armes. Le roman n’oppose pas naïvement la foi et la raison. Il montre comment la croyance, dans sa puissance collective, peut être captée, instrumentalisée, retournée en carburant de domination. Une découverte archéologique, qui devrait relever du savoir et de la transmission, se met soudain à peser comme une charge explosive, parce qu’elle touche au sacré, et que le sacré, dans un pays meurtri, peut devenir le raccourci le plus brutal vers la soumission.

La tablette, les écritures anciennes, la promesse d’un stūpa contenant des reliques, tout cela n’est pas seulement une énigme savante, c’est une matière politique. Il suffit qu’un pouvoir comprenne qu’il peut s’y accrocher pour se fabriquer une ascendance, une lignée, une histoire sanctifiée, et la vérité cesse d’être un bien, elle devient une monnaie. Le texte dit clairement la tentation d’une junte qui utiliserait ces reliques comme un levier de légitimité sacrée, nourrie de pratiques de yadaya mêlant astrologie, numérologie et gestes symboliques, et nous comprenons que le roman vise juste parce qu’il montre la frontière tremblante entre rite et manipulation, entre signe et superstition gouvernante.
Cette question du signe est au cœur de l’ouvrage, et c’est ici que notre lecture maçonnique s’éveille.
Car ce que le roman interroge, au fond, c’est notre rapport à l’invisible, et la responsabilité qui vient avec lui
La vérité n’est pas seulement ce qui est exact, elle est ce qui libère ou ce qui enchaîne selon l’usage qui en est fait. La quête de vérité et la quête de liberté se superposent, non parce que l’auteur confondrait les registres, mais parce qu’il souligne une loi plus grave, celle qui veut que l’oppression s’alimente d’un récit, et que briser l’oppression oblige à briser le récit qui l’entretient. C’est pour cela que les deux temporalités se répondent comme deux planches posées en miroir. Anthony Preston, archéologue britannique pris dans l’effondrement d’un empire et dans les trahisons d’une fuite, porte la découverte comme un fardeau mortel. Khin Yadanar, médecin au sein de la résistance Chin, reprend la quête dans un pays ravagé par une guerre civile contemporaine, et nous voyons alors que la transmission, dans ce roman, n’a rien d’un héritage paisible. Elle ressemble à une torche qu’il faut tenir dans le vent, au prix des brûlures.
Le personnage de Khin Yadanar impose une présence singulière, parce que l’auteur ne la réduit jamais à une figure de courage décoratif
Il la montre en situation, au plus près de la matière humaine, dans la boue, sous la pluie, au milieu de moyens dérisoires, avec le manque comme horizon. Nous la suivons lorsqu’elle se précipite vers une civière de fortune, tissu et bambou, portant un blessé qui suffoque. La scène se charge d’un symbolisme discret et tranchant. La médecine devient ici un art de la mesure, une géométrie du vivant qui cherche une ouverture là où tout se ferme. Le roman insiste sur la pauvreté des ressources, sur l’improvisation contrainte, sur la diaspora qui envoie de quoi drainer un thorax. Il y a dans cette économie de survie une leçon initiatique. La fraternité n’est plus un mot, elle devient un geste qui traverse les distances, et la résistance n’est pas seulement militaire, elle est morale, elle est le refus de plier le genou. Le cri collectif, « doh ayay », ne relève pas de la rhétorique, il résonne comme une formule de redressement intérieur, un rappel que la dignité commence dans la colonne vertébrale.
C’est ici que le titre du roman prend une densité particulière
Rompre le cycle ne signifie pas vaincre une fois pour toutes. Cela signifie apprendre à reconnaître les causes, discerner les engrenages, refuser le scénario qui se rejoue en changeant simplement les visages. Le texte le dit avec une cruauté lucide, les acteurs se succèdent mais les tirades restent, et ce constat s’applique autant à la guerre qu’à la famille, autant à l’histoire qu’à l’intime. Une des forces du roman est de faire sentir que la violence collective se propage aussi par les structures ordinaires, par les héritages, par les lâchetés minuscules, par la convoitise qui se déguise en droit. Dans la séquence de Cambridge, lorsque la mort rassemble une famille dispersée, nous percevons que la mort, dans ce récit, ne sert pas seulement à faire pleurer. Elle sert à dévoiler. Le deuil devient une lampe crue sur ce que nous sommes quand la présence disparaît. L’auteur ose une image antique, l’armée d’Alexandre pillant Persépolis, pour dire la rapacité familiale. Là encore, la répétition, le cycle, se manifeste, et nous saisissons combien l’héritage matériel peut devenir la version domestique d’une conquête.
Le passage de Cambridge a une importance symbolique majeure pour notre regard maçonnique, non parce qu’il multiplie des références, mais parce qu’il met en scène une tension que nous connaissons.
Le temple de Bateman Street, le damier noir et blanc, le pavé mosaïque qui semble absorber la lumière, les trois coups de maillet, la colonne du Midi, la colonne du Nord, les gants immaculés, les sautoirs, le delta lumineux, les deux globes, tout cela compose une géographie rituelle où l’âme est censée se mesurer. Pourtant Ayaan ne parvient pas à déposer ses métaux. Cette incapacité est décisive. Elle dit que l’initiation ne commence pas quand un rite s’ouvre, elle commence quand nous acceptons d’être délestés. Et Jak Bazino choisit un personnage qui se tient à la lisière, attiré par l’idée de réseau et de carrière, rebuté par ce qu’il imagine comme des usages obsolètes. Son scepticisme, parfois mordant, nous intéresse parce qu’il oblige à distinguer l’essentiel du décor. Le roman pointe la tentation du fantasme complotiste, et il le fait en montrant une assemblée de vieillards qui n’a rien de l’armée secrète rêvée par les crédules. Cette désacralisation ironique a sa fonction. Elle nettoie le regard, elle empêche la fascination, elle oblige à retrouver le cœur du symbole.
Mais le roman va plus loin, et c’est là qu’il devient, pour nous, plus qu’une simple évocation maçonnique

À Rangoun, le Masonic Hall apparaît comme un signe ambivalent, à la fois emblème des Lumières et emblème d’une uniformité culturelle imposée aux peuples conquis. Le texte prononce « Vae victis », et cette formule résonne comme une condamnation de l’orgueil civilisateur. Les colonnes, le delta du fronton, l’illumination promise, tout cela se trouve saisi par la question coloniale. Le seuil devient un interdit. Anthony Preston est trop jeune pour être initié, il demeure profane, et ce statut n’est pas anecdotique, car il conditionne sa relation au secret et à la culpabilité. Il entre pourtant, avec un sentiment de transgression, et l’auteur décrit l’espace avec une précision qui n’est pas gratuite, les colonnes Jakin et Boaz, le pavé mosaïque, le pupitre du Vénérable Maître à l’Orient, le cierge qui fait danser l’équerre et le compas. Cette description ne vise pas à flatter une culture de l’allusion. Elle sert à installer une chambre d’écho. Car dans cette loge dépouillée, où le secrétaire est parti avec les meubles, l’auteur fait entendre une phrase qui dépasse l’anecdote, « il ne reste vraiment plus rien », et nous comprenons qu’il parle à la fois d’un lieu, d’un ordre du monde, d’un empire qui se retire, et d’une vie qui se vide. La loge devient alors une métaphore d’un monde en démeublement, et la question initiatique se retourne. Que reste-t-il quand les ornements tombent, quand les titres, les protections et les certitudes se retirent. Reste le silence, et dans ce silence, la possibilité d’une rectitude, ou la tentation du mensonge.

Ce roman est aussi une méditation sur la manière dont l’Histoire utilise les individus, et sur la manière dont certains individus, pourtant, parviennent à dévier légèrement la trajectoire. C’est souvent ainsi que les cycles se brisent, non par une victoire totale, mais par une variation, une inflexion, un refus au bon endroit. Anthony Preston voit la répétition à l’œuvre et s’interroge, non sans vertige, sur ce que produira sa mort. Cette question est moins morbide qu’elle n’en a l’air. Elle touche à la transmission karmique du geste. Dans la tradition hermétique comme dans la tradition maçonnique, le geste n’est jamais isolé. Il s’inscrit dans une chaîne, il appelle une conséquence, il nourrit une forme. Le roman traduit cela en images concrètes, la sacoche comme lien au passé, la peur d’être effacé si le contenu disparaît, et cette hantise de l’effacement, dans un pays où l’autodafé peut être littéral, où l’incendie de dépôts et de raffineries devient l’incendie d’une enfance et d’un avenir. Quand l’auteur décrit la fumée noire, et la sensation que toute trace sera bientôt effacée, il ne parle pas seulement d’un épisode de guerre. Il parle de ce qui se joue dans toute oppression, la destruction des preuves, la destruction des mémoires, la destruction des filiations. Briser le cycle, ici, signifie aussi sauver des traces, sauver des noms, sauver une continuité qui ne soit pas celle de la domination.
L’ésotérisme du roman n’est pas décoratif

Il surgit lorsque les humains cherchent une origine, une relique, un texte ancien, et qu’ils déposent sur cette source l’espoir d’une unité perdue autant que le désir d’un pouvoir affermi. La légende de Suvannabhumi, le « pays d’or », que certains traduisent aussi par « Terre de l’Or » et que mentionnent plusieurs textes anciens, dont les Jataka, se prête à ces déplacements. Car un même récit change de lieu, de contours et de fonction au gré des intérêts politiques, et cette mobilité même devient une leçon de critique initiatique. Le roman montre comment chaque nouveau royaume souhaite se doter d’une légitimité sacrée, et comment une histoire se réécrit pour servir une souveraineté. Là encore, la répétition est le piège. Les mêmes récits se déplacent de palais en palais, de junte en junte, et l’or du mythe se change en chaîne. L’auteur insiste sur le fait que l’origine d’une légende change pour des raisons politiques, et cette phrase, pour nous, vaut comme une mise en garde sur nos propres mythologies intérieures. Combien de fois réécrivons-nous notre passé pour justifier ce que nous voulons devenir, ou pour excuser ce que nous refusons de regarder.
Dans ce mouvement, Rompre le Cycle travaille une question que notre tradition reconnaît, celle du rapport entre secret et vérité. Le secret peut protéger.
Il peut aussi intoxiquer. Il peut être le voile nécessaire à une maturation, ou l’opacité qui permet les pires captations. Le roman refuse de choisir une position confortable. Il montre que la vérité est dangereuse, non parce qu’elle serait scandaleuse, mais parce qu’elle est convoitée. Et il montre, en miroir, que l’absence de vérité laisse le champ libre aux légendes fabriquées, aux rites détournés, aux superstitions gouvernantes. Nous retrouvons ici un motif profondément maçonnique, celui du discernement, non comme une vertu abstraite, mais comme une nécessité vitale. Entre la lumière qui éclaire et la lumière qui aveugle, il existe une différence de régime intérieur. Et ce roman, à sa manière, travaille cette différence.
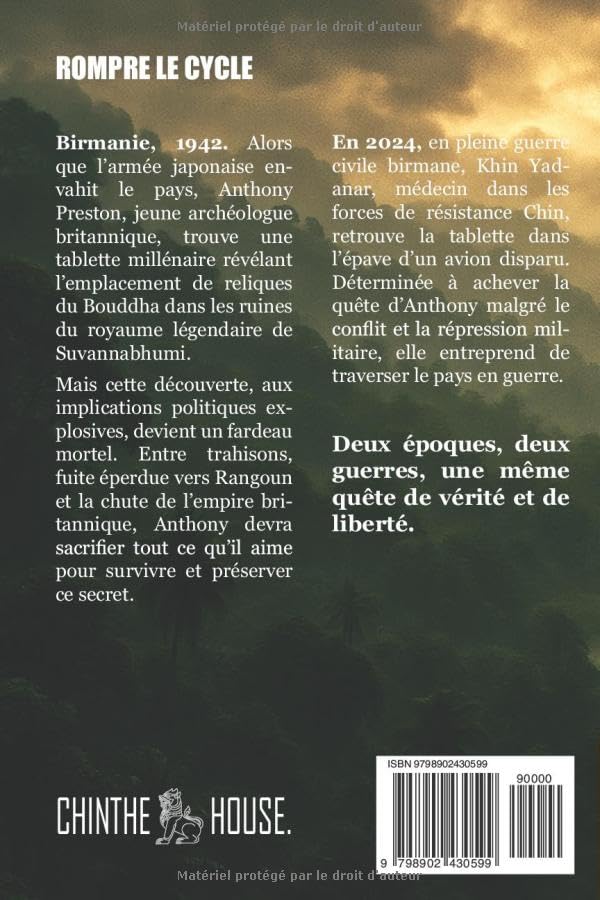
Il faut aussi entendre la dimension affective, parce que Jak Bazino ne laisse pas la guerre absorber tout le sensible
À travers les destins croisés, les séparations et les retrouvailles impossibles, le roman installe une rime secrète entre 1942 et 2024, non comme un artifice, mais comme une loi intime du temps, celle qui fait que les mêmes déchirures reviennent frapper aux mêmes portes, avec d’autres noms, d’autres visages, et pourtant la même morsure. Dans la logique du cycle, l’amour devient lui aussi un lieu d’épreuve, non par sentimentalité, mais parce qu’il est l’endroit où l’humain résiste à sa propre déshumanisation. Là où tout pousse à devenir instrument, où la peur impose sa grammaire et où la violence veut réduire l’être à sa fonction, l’amour rappelle la finitude, la vulnérabilité, la possibilité d’un lien qui ne s’achète pas, qui ne se commande pas, qui ne se décrète pas. Ce lien est fragile, souvent empêché, parfois sacrifié, et c’est précisément cette fragilité qui fait sa valeur initiatique, parce qu’elle oblige à choisir entre la possession et la fidélité, entre l’avidité et la présence, entre la survie nue et la dignité partagée. Nous ne sortons pas du cycle par la seule force. Nous en sortons parfois parce qu’un visage, une main, une promesse, nous interdit de devenir ce que la guerre exige de nous.
Dans la manière d’écrire, Jak Bazino semble choisir une prose qui supporte la documentation sans s’y noyer
Il choisit, du moins nous semble-t-il, une écriture capable de nommer des réalités précises, qu’il s’agisse d’un rituel d’Émulation et de son héritage britannique, ou des pratiques de yadaya, ou des structures de résistance Chin, sans perdre le fil romanesque. Le résultat, lorsqu’il est réussi, donne cette sensation rare d’un roman qui ne triche pas, qui ne maquille pas la complexité, et qui pourtant garde une intensité narrative. Ce n’est pas un texte qui distribue des bons points. C’est un texte qui rend sensible la manière dont les êtres se débattent dans des forces qui les dépassent, tout en montrant que certains gestes, certains refus, certains choix minuscules, peuvent devenir des ruptures.
Et c’est là, pour nous, le point le plus initiatique du livre
Briser le cycle n’est pas seulement renverser un régime ou survivre à une guerre. Briser le cycle consiste à interrompre en soi la logique qui reconduit le mal sous d’autres masques. Le roman l’exprime par le karma et par l’histoire, mais nous pouvons l’entendre comme une discipline intérieure. Nous portons tous une part de répétition. Nous portons des colères héritées, des peurs transmises, des justifications apprises. Le roman fait sentir que l’oppression collective se nourrit des automatismes intimes, et que la libération commence lorsque nous cessons d’applaudir ce qui nous fait pleurer, lorsque nous cessons de confondre spectacle et vérité, lorsque nous acceptons de regarder les causes, même lorsqu’elles nous accusent.
Quelques mots enfin sur Jak Bazino, parce que l’œuvre se laisse mieux comprendre lorsque nous percevons d’où elle parle
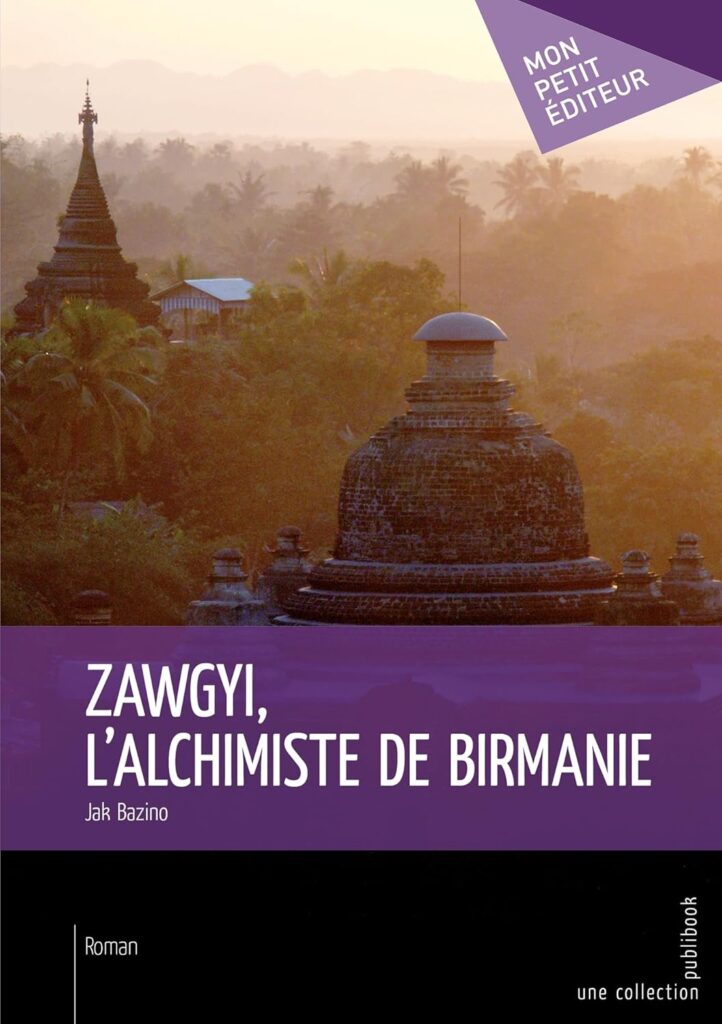
Jak Bazino est un écrivain français, diplômé en sciences politiques et en relations publiques, qui a vécu plus de dix ans au Myanmar, d’abord sous le régime militaire puis durant la période de transition, en parcourant le pays et en approfondissant sa connaissance de la population, des croyances et de l’histoire. Il a quitté le Myanmar peu après le coup d’État militaire de février 2021, dont il a été témoin dans sa violence faite à la population. Cette longue immersion donne au roman une texture particulière, une attention aux réalités concrètes qui évite l’exotisme. Dans sa bibliographie, Jak Bazino a publié en 2012 un premier roman, Zawgyi, l’alchimiste de Birmanie. Ce titre ancien, avec sa figure d’alchimiste, éclaire rétrospectivement Rompre le Cycle, comme si l’auteur poursuivait une même interrogation, celle des transformations, des métaux intérieurs, de ce que l’humain peut transmuer en lui lorsque l’Histoire le broie.
Rompre le cycle
Jak Bazino – Staten House, 2026, 464 pages, 6,35 € – numérique 8,55 €
Pour commander, c’est ICI

